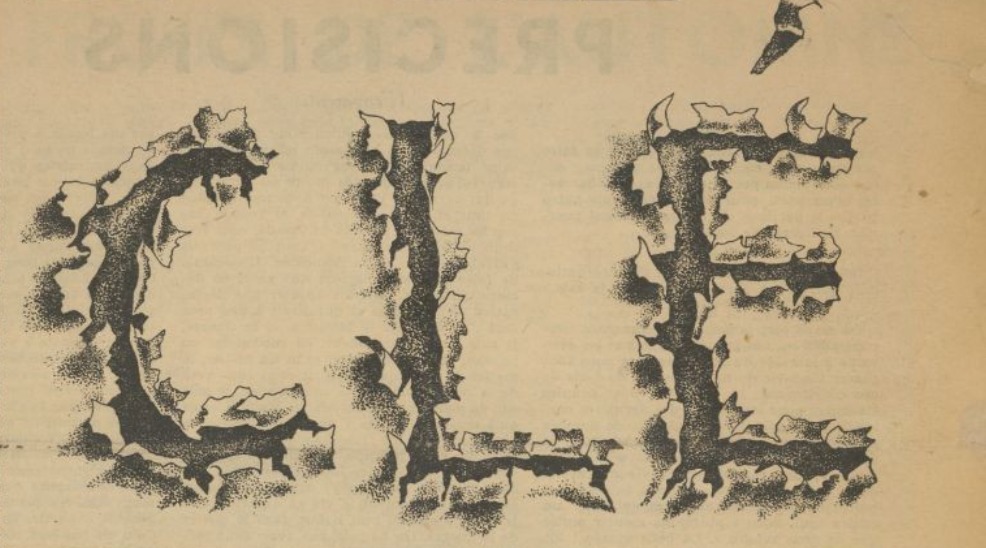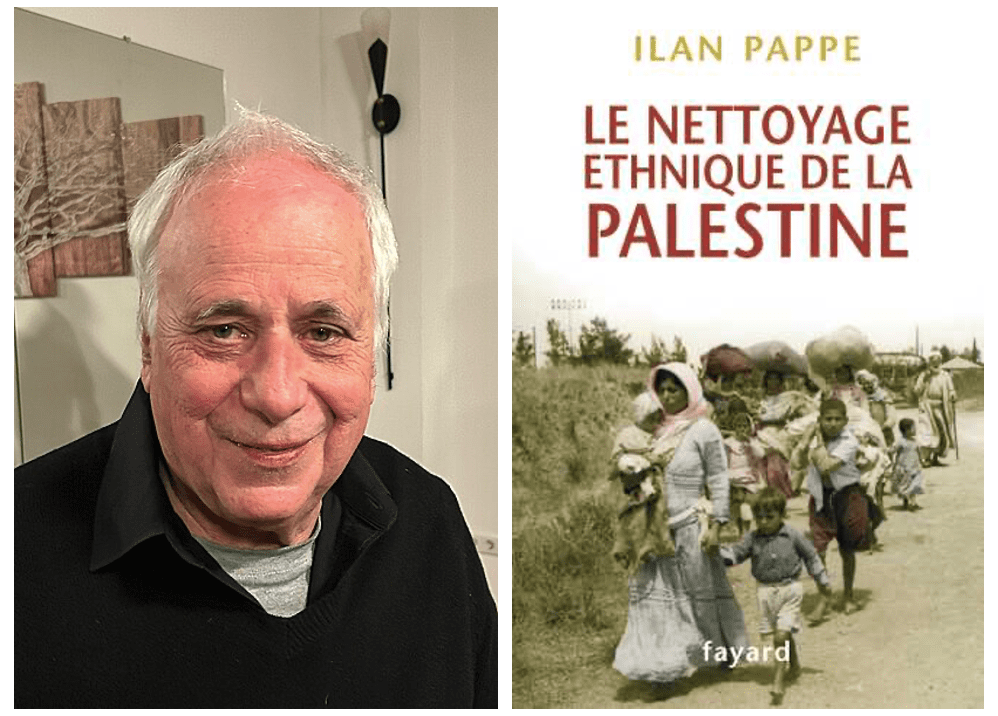Crédits photos : Black Label Media / Thunder Road Pictures / Scott Free Productions
Retour des Replicants dans l’univers languissant de Denis Villeneuve
Denis Villeneuve est en forme : après Sicario et Arrival, qui ont été tout deux des succès, le réalisateur a franchi un nouveau pas avec Blade Runner 2049, la suite d’opus de Ridley Scott de 1982, Blade Runner. Retour donc dans un futur pas si lointain, deux ans avant la date de péremption du film original, qui se déroulait en 2019. Trente ans après, K, un replicant superflic traque toujours les Nexus 8 en liberté, des robots qui ont souhaité s’affranchir de l’esclavage qui a été leur raison de naître. La Tyrell Corporation a cédé la place à la Wallace Corporation, dans un monde post-apocalyptique où seule l’ingénierie agroalimentaire a pu sauver le monde d’une famine mortelle. Dans cet univers pas si loin du nôtre, l’espèce humaine a commencé à coloniser de nouveaux monde et a façonné pour cela des androïdes esclaves, les Replicants, chargés de mettre en valeur ces nouveaux mondes. Cependant, la première génération d’androïdes s’est rebellée et la police et son unité spéciale, les Blade Runner, les traque toujours. Au cours d’une énième mission, K, qui fait partie de cette unité, « retire » un Replicant en fuite avant de découvrir un secret lourd de conséquence sur l’avenir des rapports entre androïdes et robots qui va être le moteur de l’intrigue.
Lumière, cadrage : un chef d’oeuvre visuel qui dépasse les attentes
Si le film n’a pas convaincu tout le monde, tous s’accordent sur l’immense réussite que sont la mise en scène et la photographie du film. Roger Deakins, directeur de la photographie, pourrait ainsi être crédité comme réalisateur tout autant que Denis Villeneuve, le metteur en scène. On s’y balade dans un Las Vegas dévasté par des bombes nucléaires où la poussière ocre se fond avec un soleil crépusculaire, dans un salon au milieu d’un étang où les lumières scintille sur des murs d’or, dans une décharge à perte de vue ou encore dans des rue de Los Angeles tout aussi sombres que dans le premier opus ; à chaque plan, le chef opérateur, qui avait déjà travaillé de nombreuses fois avec Denis Villeneuve, s’illustre dans des tableaux magnifiques.
Les décors reprennent quant à eux dans une large partie l’imaginaire visuel de Ridley Scott, même si le film prend le temps de poser un univers dystopique où la ville comme la campagne apparaissent comme des aberrations, sur une planète plus déformée que jamais. Si on ressent moins l’atmosphère de crasse qui dégoulinait dans la traque de Rick Deckard, on voir les mêmes inspirations chères aux univers cyberpunk que Blade Runner avait largement popularisée : la façon de voir cette Terre dévastée ne peut que rappeler les planches de Moebius ou Enki Bilal, selon les plans.
Les androïdes ont-ils une âme ? L’instable frontière entre humains et androïdes
Blade Runner 2049 n’invente rien dans les grandes questions qu’a pu poser la science-fiction : au coeur du cheminement des personnages, la question de la différence entre les robots et les humains, sur ce qui fait « l’humanité ». Si, dans le premier film, la frontière entre hommes et robots était déjà au centre de l’intrigue, tout dans ce film tend à réduire la frontière entre les deux mondes, « frontière sur laquelle tout repose », comme l’explique Robin Wright, dans un rôle de lieutenant de police tiré à quatre épingles. Ainsi, dans la scène d’exposition, on est saisi de voir ce Nexus 8 étrangement humain, qui cultive de l’ail et dont la casserole en ébullition ramène plus aux repas de votre enfance qu’à un androïde tueur. De même, lors de la naissance d’une Replicant dans les laboratoires de la Wallace Corporation, même si les délires divins de Jared Leto ramènent aux pires idées d’Aliens Covenant, la figure de ce robot (est-ce un clone ?) frêle et dégoulinant d’un liquide amniotique non identifié ramène ces androïdes à une existence bien humaine. Tout cela se déroule pendant que de l’autre côté, les humains semblent avoir une existence encore plus misérable et aliénée que leurs « peaux de robots », d’un l’orphelinat géant installé dans une ancienne fonderie où les gosses trient des déchets métalliques pour en extraire le nickel aux rives de l’océan Pacifique bordé par des murailles métalliques de centaines de mètre de haut, loin de l’image touristique qu’on en a aujourd’hui.
Jared Leto, le multi-milliardaire qui se veut être le grand antagoniste du film, ne cesse de parler, dans une rhétorique bien chrétienne, de l’Eden, de l’âme que pourraient avoir ou non ses Replicants, bien qu’à mon sens, la question de « l’âme », qui dépasse la question de la subjectivité de l’individu pour lui donner une raison mystique d’exister, devrait rester dans les affabulations d’un grand méchant dont le rôle est ici superflu. Le film questionne ce qui fait la différence entre l’humain et le robot, et propose, au-delà de « l’âme », d’autres possibilités de frontières entre humains et androïdes, notamment la capacité à enfanter, une question qui semble pourtant centrale : celle de la subjectivité des Replicants. Leur nature, entre les robots et le clone, ne permet de déterminer a priori leur capacité à ressentir les émotions ; Ryan Gosling, qui joue un agent K capable d’encaisser les coups au point où durant les trois quarts du films, l’acteur a le visage tuméfié et recouvert de sang séché, renforce cette question, avec un jeu imperturbable dans la droite lignée de Only God Forgive. Le personnage, malgré sa vie des plus aliénantes, les coups qu’ils reçoit et la conscience d’une existence vouée à l’esclavage ne semble pendant tout le début du film ressentir aucune émotions. Cependant, dans un film qui veut faire ressentir tout autant que faire réfléchir, c’est justement ces émotions, difficilement palpables au début chez Ryan Gosling, évidentes à la fin du film, qui ne me font dire que ces Replicants ressentent bien des émotions, au-delà des rêves implantés dans leurs mémoires.
Les robots se sentent-ils seuls ? Vision dystopique d’une société plus solitaire que jamais
S’il fallait se convaincre que les Replicants étaient doués de sentiments, l’amour que porte K à un personnage holographique qu’il emmène partout avec lui, incarné par Ana de Armas, achève de convaincre des sentiments (bien tristes) des androïdes. Produit par la firme Wallace, des figures holographiques, dont les publicités publiques consistent à montrer des femmes nues hautes comme des immeubles de 20 étages, traduisent la solitude qu’imaginent les scénariste de ce futur dystopique : JOI est « tout ce que vous voir ; tout ce que vous voulez entendre ». Cette solitude émotionnelle que l’industrie tente de combler en vendant ces personnages virtuels atteint son comble lorsque Joi, la compagne numérique K, lui propose de dépasser le vide affectif de leur relation en matérialisant leur amour dans une scène de sexe avec une prostituée sur laquelle l’hologramme de Joi vient se superposer. Dans Her, Joaquin Phoenix entretenait une relation amoureuse avec une intelligence artificielle qui gérait son ordinateur dont on ne connaissait que la voix (celle de Scarlett Johansson) ; ici, c’est un hologramme qui vient remplir le manque affectif qui ronge la société, rendant encore plus ténue la frontière entre virtuel et réel, et encore plus révulsante l’état des relations entre individus dans ce futur post-apo.