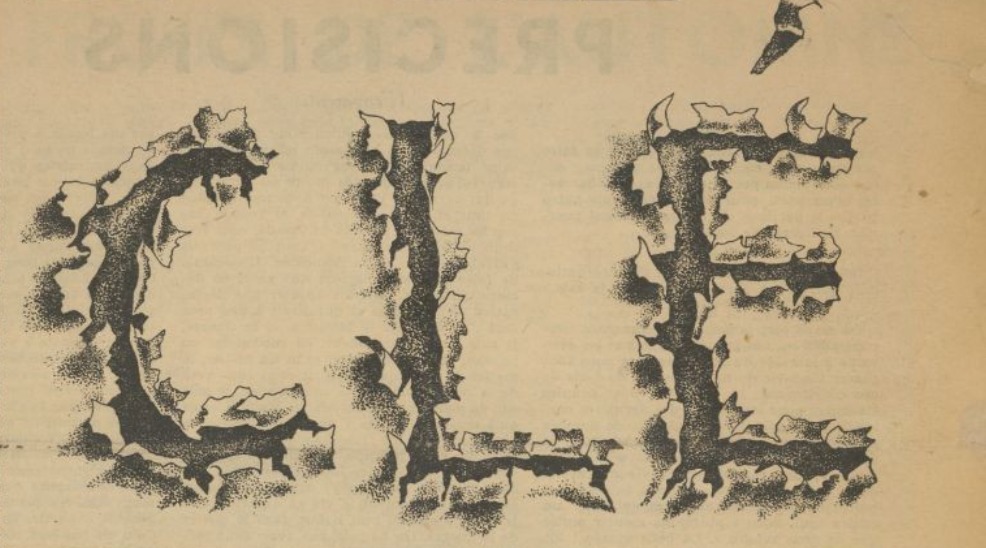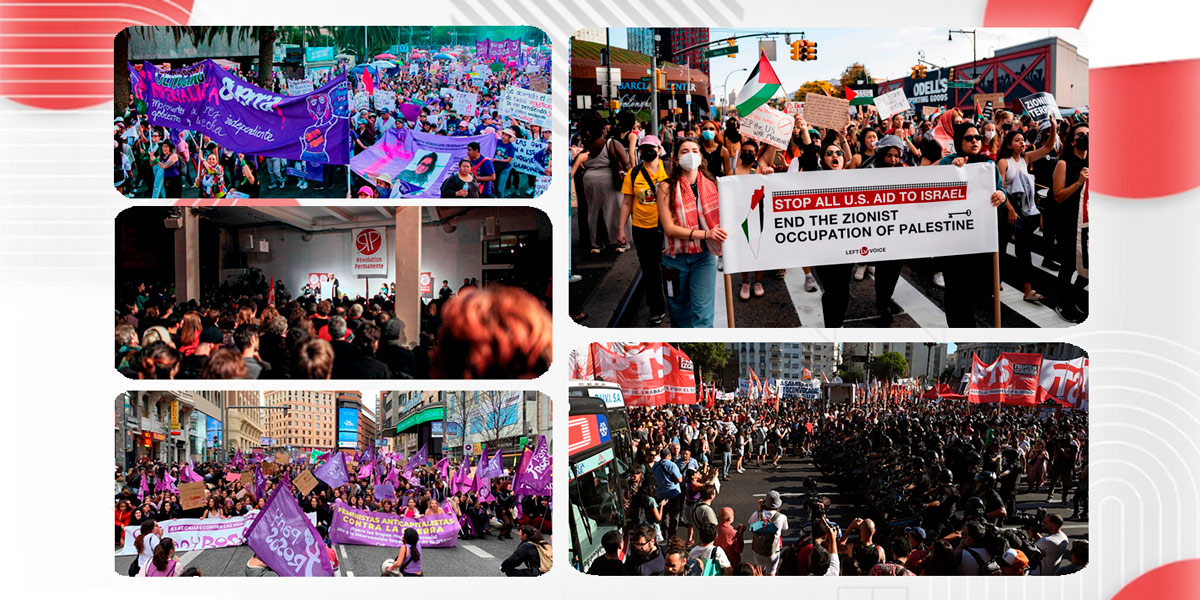Sept ans après L’insurrection qui vient, « Les insurrections, finalement, sont venues », affirme liminairement l’opus A nos amis [1], qui entend tirer leçon de la séquence historique ouverte par la « crise » de 2008. Constatant la faiblesse d’une résistance explicitement anticapitaliste à l’échelle internationale, le texte revient sur la vague de soulèvements qui a agité l’actualité depuis cette date, révolutions arabes et mouvements des « places » (Puerta del Sol, Tahrir, Taksim,… « Occupy » Wall Street et ses suites)...
1. Derrière la lecture des « insurrections », quelle vision de la production et du pouvoir ?
Contrairement à la thèse marxiste du primat de la production du capital et de la plus-value, au sens d’un processus logiquement distinct de la circulation et de la réalisation de ces derniers, A nos amis affirme que les frontières entre production, circulation et reproduction sont devenues poreuses au point que les processus de production et de circulation de la valeur ont fusionné [2].
« Les marxistes peuvent se rhabiller : le processus de valorisation de la marchandise, de l’extraction à la pompe, coïncide avec le processus de circulation, qui lui-même coïncide avec le processus de production, qui dépend d’ailleurs en temps réel des fluctuations finales de la théorie du marché. Dire que la valeur de la marchandise cristallise le temps de travail de l’ouvrier fut une opération politique aussi fructueuse que fallacieuse. […] dans un monde où l’organisation de la production est décentralisée, circulante et largement automatisé, où chaque machine n’est plus qu’un maillon dans un système intégré de machines qui la subsume, où ce système-monde de machines, de machines qui produisent des machines, tend à s’unifier cybernétiquement, chaque flux particulier est un moment de la reproduction d’ensemble de la société du capital. Il n’y a pas plus de "sphère de la reproduction", de la force de travail ou des rapports sociaux, qui serait distincte de la "sphère de la production" . » [3]
L’appareil industriel des pays capitalistes centraux a effectivement subi depuis les années 70 toute une série de transformations dont il faut prendre la mesure. Les concentrations classiques se sont transformées en usines « diffuses », en « écosystèmes » plus complexes, où l’envers de la multitude de sous-traitants agglomérés en réseaux hiérarchisés est la prolifération de tâches éclatées assurées par une main-d’œuvre de plus en plus flexible, indifférenciée, atomisée (« précaire » ou non) qui semble de plus en plus intervenir comme simple « vigile des machines » [4]. De même certains secteurs des services sont devenus de plus en plus centraux, comme les finances ou, surtout, le transport : la poste, les réseaux autoroutier, aérien, maritime ou ferroviaire sont maintenant des nœuds stratégiques augmentant les possibilités concrètes d’interrompre la production, en plus des grèves sur les sites productifs mêmes, par le biais de « blocages ». L’organisation actuelle de la production revêt ainsi un aspect de « réseau » suffisamment impressionniste au premier abord pour donner l’idée d’une véritable mutation qualitative, dont un volet serait naturellement la fin définitive de la classe ouvrière d’antan. Mais dire tout court à l’aune de ces évolutions que l’appareil de production de biens et services (qu’il soit entreprises ou bureaux, « privé » ou « public »), n’est plus le centre stratégique de l’économie capitaliste (sa fonction essentielle, quoique résiduelle, étant maintenant politique, la production de sujets consentants du capital, de producteurs et de consommateurs attachés à l’ordre du travail), revient à affirmer que ce centre,la production de la plus-value, a disparu comme centre, et qu’il n’existe donc plus que réseaux et dispersion [5].
A nos amis prend pour argent comptant le phénomène apparent de cette dispersion, pour en faire une réalité censée témoigner qu’une mutation a affecté la logique du capital. La formule creuse de « tendance à l’unification cybernétique » révèle l’impensé sous-jacent. Une étude méticuleuse permet au contraire de distinguer, par exemple, les points ou conditions dans lesquels il peut effectivement y avoir quelque chose comme une « coïncidence » objective entre production et circulation (en résumé, lorsque les flux marchands sont des étapes du procès productif, ce qu’ils ne sont pas la plupart du temps, par exemple dans les flux commerciaux), de l’idée caricaturale selon laquelle production et circulation auraient fusionné en général [7]
Le mythe du pouvoir « logistique » et sa conséquence : adieu le prolétariat, vive les anonymes et bloquons tout !
{{}}Tout marxiste est d’accord pour dire que le pouvoir du capital est un pouvoir fondamentalement matériel logé dans l’organisation des infrastructures. Le problème est qu’ici on ne parle plus, ou plus nécessairement, des mêmes infrastructures :
« Cette dernière [la "sphère de la production"] n’est d’ailleurs plus une sphère, mais plutôt la trame du monde et tous ses rapports. Attaquer physiquement ces flux, en n’importe quel point, c’est donc attaquer politiquement le système dans sa totalité. »[8]
Et la « production » restant le nœud du pouvoir, celui-ci aussi s’est fait « monde ». Production et pouvoir sont donc partout, disséminés horizontalement, sans hiérarchisation. Thèsefoucaldienne par excellence, qui diffuse le pouvoir au point de le diluer : « Le pouvoir est désormais immanent à la vie telle qu’elle est organisée technologiquement et mercantilement » [9]. Or si « Le pouvoir, désormais, est l’ordre des choses même, et la police chargée de le défendre », n’importe quoi de ce capital-pouvoir-devenu-monde-matériel fait dès lors l’affaire pour entrer en guerre, n’importe qui peut s’y mettre n’importe où et n’importe quand, du moment qu’il affronte une « infrastructure »et sa bande armée policière. Attaquer une banque, occuper une zone contre la construction d’un aéroport ou d’un barrage, bloquer une autoroute, une université, ou déclencher une grève dans une usine, tout cela se vaut,à chaque fois avec la même portée. C’est cette mise en équivalence généralisée des points d’attaque que le mot d’ordre « bloquons tout » concentre, avec une conséquence majeure :
Si le sujet de la grève était la classe ouvrière, celui du blocage est parfaitement quelconque. C’est n’importe qui, n’importe qui décide de bloquer – et prend ainsi parti contre la présente organisation du monde. » [10]
Si bloquer les flux circulatoires suffit pour bloquer les flux productifs, les « blocages » sont même stratégiquement plus névralgiques que les grèves car ils permettent à tout un peuple potentiel d’anonymes d’entrer en guerre, alors que les grèves ne concernent que les prolétaires employés. Ce ne serait donc définitivement plus vers la classe ouvrière d’aujourd’hui (pourtant majoritaire, en France comme à l’échelle de la planète), du reste tellement atomisée et ayant perdu sa conscience d’elle-même, qu’il faut se tourner. De façon plus générale, on n’est pas seulement frappés par cette méprise (explicite) sur la classe ouvrière, et le mépris (implicite) à son égard, mais par l’absence chronique des classes en général : il y a capitalisme, pouvoir, mais il n’y a plus de bourgeois et d’exploiteurs (rejeter les classes et l’idée d’un pouvoir de classe était déjà la conséquence de la vision de Foucault). D’où la combinaison des deux équations occuper =bloquer [11] et bloquer = s’insurger, à condition que cela s’incarne dans autre chose qu’une simple « indignation » au fond consensuelle, le livre brocardant à juste titre cette catégorisation rétrospective appuyée sur le livre de Hessel.
L’idée du « blocage de la production » hors du strict lieu des usines n’a pourtant rien de nouveau. Le pouvoir capitaliste a toujours été contrôle autant des moyens de production que des moyens de circulation, et les révolutionnaires de 1917 savaient très bien le potentiel désorganisateur, contre le pouvoir tsariste puis kerenskiste, d’une attaque des chemins de fer par exemple. Bien sûr faut-il reconnaître et utiliser ce pouvoir spécifique, mais sans pour autant le confondre avec celui des grèves, et en particulier les grèves avec occupations des lieux de production, où émergent les seuls cadres d’auto-organisation mettant de fait en question la propriété capitaliste. L’enjeu est avant tout l’optimisation de leur combinaison tactique, en vue, à terme, de la grève générale, qui seule est capable de poser au plan économique comme politique la question du pouvoir comme cristallisation d’un antagonisme de classes. Même si elle ne résout pas à elle seule cette question, comme mai 68 l’a montré, elle seule actualise la condition de possibilité de l’affrontement révolutionnaire et la préparation de l’insurrection comme art véritable, et pas comme simple métaphore.
2. La puissance contre le pouvoir : l’éternelle pirouette autonome
La question de l’Etat
L’autre facette de la logique selon laquelle « Le gouvernement n’est plus dans le gouvernement… Le pouvoir, désormais, est l’ordre des choses même, et la police chargée de le défendre »[12], c’est qu’elle a pour résultat de nier tout simplement la question du pouvoir. Le développement du salariat capitaliste dans des conditions d’égalité formelle des prolétaires et des bourgeois, a pour un temps remisé aux coulisses le rôle de l’Etat, visiblement incontournable, en comparaison, dans le féodalisme. Mais Marx a mis en évidence l’erreur consistant à prendre pour argent comptant cette capacité endogène du capital de secréter l’apparence de sa propre naturalité (c’est le « fétichisme de la marchandise ») et de son fonctionnement comme un quasi-sujet indépendant. En réalité la condition fondamentale de sa reproduction d’ensemble, la reproduction de la propriété privée et de la division en classes, a toujours supposé le pouvoir d’Etat, en témoigne le processus de l’accumulation primitive militairement et juridiquement accompagné par l’Etat anglais, ou le fonctionnement structurel du XXe siècle impérialiste, qui a généralisé l’immixtion des Etats non seulement comme garant de cette reproduction du système, mais comme soutien direct du procès de production. Quant au rôle crucial récemment joué par les Etats pour éviter la banqueroute totale du système financier international, est-il indispensable de revenir dessus une fois de plus ?
Qu’aujourd’hui la production matérielle soit plus déconcentrée qu’il y a quelques décennies ne signifie aucunement que le capital se soit lui déconcentré, au contraire, ni que les Etats ne soient pas des éléments déterminants dans les formes de sa concentration (c’est évident dans des secteurs comme l’armement ou le nucléaire, mais l’est y compris dans ses logiques de « désengagement » comme les privatisations). Chaque lutte ouvrière ou sociale potentiellement désorganisatrice, qui suscite la répression sur ordre d’un gouvernement, le montre aussi avec limpidité. Et si l’on suit l’analyse par Gramsci des Etats occidentaux depuis l’entre-deux-guerres, et le rôle paraétatique d’organisation-canalisation des masses joué de façon croissante par certaines institutions de la société civile (ce qu’il appelait l’Etat « élargi ») comme les centrales syndicales bureaucratisées et réformistes, on voit encore plus clairement que la bourgeoisie tient entre ses mains, directement ou indirectement, éventuellement sous forme contradictoire ou en tension (par exemple dans les « services publics ») le pouvoir d’Etat [13].
{{}}
Spontanéité, organisation, auto-organisation
« Le soulèvement dure quelques jours ou quelques mois, amène la chute du régime ou la ruine de toutes les illusions de paix sociale. Il est lui-même anonyme : pas de leader, d’organisation, pas de revendication, pas de programme. Les mots d’ordre, quand il y en a, semblent s’épuiser dans la négation de l’ordre existant, et ils sont abrupts : "Dégage !", "Le peuple veut la chute du système !"… Ce qui se lève n’a personne à placer sur le trône en remplacement, à part peut-être un point d’interrogation. Ce ne sont ni les bas-fonds, ni la classe ouvrière, ni la petite-bourgeoisie, ni les multitudes qui se révoltent. Rien qui ait assez d’homogénéité pour admettre un représentant. Il n’y a pas de nouveau sujet révolutionnaire dont l’émergence aurait échappé, jusque-là, aux observateurs. Si l’on dit que le "peuple" est dans la rue, ce n’est pas un peuple qui aurait existé préalablement, c’est au contraire celui qui préalablement manquait. Ce n’est pas le "peuple" qui produit le soulèvement, c’est le soulèvement qui produit son peuple » [14].
La contradiction du livre se fige ici : ce genre d’insurrection tout en n’étant pas la révolution, est pris comme modèle, et réciproquement. L’idée centrale est que ces soulèvements de masse ont témoigné d’un degré d’auto-organisation tel, à l’image de la capacité des insurgés boliviens en 2003 à s’appuyer sur les réseaux de relations de quartiers, de famille, etc. pour mener des actions d’envergure (blocages, barricades, manifestations massives, actions militaires offensives de type guérilla, etc.), qu’il rend « stérile » et « dissout » la distinction entre « spontanéité et organisation », l’argument principal étant qu’« Il n’y a pas d’un côté une sphère pré-politique, irréfléchie "spontanée" de l’existence, et de l’autre une sphère politique, rationnelle, organisée. » [15] Sans revenir sur les débats sans fin sur cette question, qui sera en désaccord avec cet argument ? Seules les pensées réactionnaires ou foncièrement droitières ont martelé, depuis les révoltes de la plèbe antique jusqu’à celle des banlieues hexagonales de 2005, que l’action spontanée des masses était par définition irrationnelle, animale et politiquement inapte. Au contraire toute l’histoire révèle leur créativité, et pour prendre un exemple marquant et récent à l’échelle de l’histoire, les révolutions de 1905 et février 1917 en Russie, on voit à quel point les luttes ouvrières non organisées par un parti étaient loin de se réduire, par exemple, à des grèves apolitiques ou purement économiques. La création des soviets, cadres d’auto-organisation par excellence, fut la preuve de cette créativité et de son contenu politique. Mais cela ne revient pas à dire que cette auto-organisation spontanée suffit pour enclencher la phase de concrétisation de l’offensive révolutionnaire contre le capital.
« Spontanéité » et « organisation » dans l’insurrection d’El Alto (Bolivie 2003)
L’insurrection sociale d’El Alto en 2003 a été le point le plus élevé d’un mouvement de masse dont l’avant-garde, réussissant à unifier des composantes sociales variées (mouvement civique chez certaines fractions de classes moyennes, étudiants, travailleurs des services publics de la santé, revendications nationales-indigènes du peuple originaire Aymara, mouvement paysan, fractions ouvrières notamment les mineurs de Huanuni), a concentré le caractère « plébéien ». La révolte s’est radicalisée à la mesure de la répression militaro-policière du gouvernement qui voulait donner satisfaction à une bourgeoisie nationale empressée de liquider tout un gisement de gaz naturel récemment découvert au profit des multinationales British Gas, British Petroleum et Repsol YPF (afin de l’exporter au Mexique et aux États-Unis). L’extraordinaire combattivitédes masses et le blocage de La Paz à l’automne 2003 ont finalement conduit à la chute du président Sánchez de Lozada le 17 octobre, et la tenue d’un référendum qui fut massivement voté d’où suivit un décret de nationalisation des hydrocarbures en 2006. Mais sur la durée, le capitalisme n’a aucunement été abattu, et c’est le pouvoir nationaliste bourgeois d’Evo Morales (élu en 2005) qui fut le grand gagnant de la période, bien plus que les classes ouvrières et populaires boliviennes [16]. A certains égards l’insurrection de l’automne 2003 a été victorieuse comme le fut le février 1917 russe, mais n’a pas ouvert, sur la durée, à une période dedouble pouvoir mettant peu à peu au centre du débat la question du pouvoir.
« Spontanéité » ne signifie aucunement absence d’organisation et d’éléments de direction. Le problème c’est la faiblesse qualitative et le manque d’une direction politique capable, à échelle de masse, de donner forme cohérente et contenu offensif au débordement déjà initié des organes réformistes, bureaucratiques (syndicaux notamment) et indigénistes, dans le sens d’une ligne d’indépendance politique capable, sur des bases de classe, de transformer la lutte défensive en un conflit proprement révolutionnaire [17]. Cette « seconde phase » comme disait Trotsky, A nos amis n’en parle pas une seule seconde, concluant en jésuite l’évocation d’El Alto sur la simple mention d’une nécessaire « disposition au conflit ».
En résumé pourquoi ces insurrections n’ont-elles pas abouti à des révolutions ? Parce qu’au sein de ces soulèvements de masse, les orientations hégémoniques ont été, l’exemple égyptien étant emblématique, celles de démocrates intrinsèquement inconséquents qui se sont appuyés sur les forces de la classe ouvrière pour mener une politique capitularde qui a conduit à la défaite, au moins pour une certaine période. [18] On peut naturellement objecter la faiblesse des mouvements ouvriers dans toutes les « indignations », mais le constat final reste celle de l’immaturité politique de ces dernières. Qu’il faille reconstruire la conscience prolétarienne à une large échelle est une évidence, mais être révolutionnaire, c’est, à cette fin, tirer leçon de cette immaturité, œuvrer à une clarté programmatique et stratégique dans le sens d’un degré supérieur d’organisation, de préparation et de direction appuyé sur ce qui reste le levier capable de faire plier le capitalisme de l’intérieur : la classe ouvrière. Voilà pourquoi parler de son hégémonie, de la nécessité d’en forger de nouvelles organisations combatives, tout en œuvrant à la reconstructiond’un « parti mondial de la révolution », est résolument antinomique avec n’importe quel ouvriérisme simpliste et la vision d’un parti révolutionnaire qui serait divin créateur ex nihilo de la conscience de classe.
{{}}
Le refus de penser la transition révolutionnaire
A nos amis se défend de tomber dans le présentisme du communisme de l’ici-et-maintenant et prétend formellement offrir un discours de la préparation patiente par quoi l’aspiration à « s’organiser mondialement », en évitant le double piège de « l’abstraction du global » et de « l’attraction du local », trouverait à s’incarner. Mais le refus d’affronter la question de la transition [19], déjà enveloppé dans celui d’affronter la question du pouvoir, conduit le texte à ne pas affronter ses propres tensions et devenir de plus en plus incantatoire [20]. Le refus de toute transcendance utopique, la proclamation que tout devenir-révolutionnaire se fera dans l’immanence totale des liens de proches en proches (« réseau » oblige, rhizome disait Deleuze), n’empêchent évidemment pas le Comité Invisible de travailler sur l’imaginaire, sur ce qu’il est et serait possible d’instituer.
Chez Marx la critique radicale de l’utopisme s’intégrait dans une vision dialectique du communisme, à la fois un « projet de société » très général, une société sans classes et sans Etat dominateur, et le « mouvement réel » des exploités et des opprimés affrontant l’ordre établi, le second étant chargé de donner progressivement son contenu au premier, celui-ci servant simultanément de boussole à l’action révolutionnaire pour qu’elle ne s’enferme pas dans le pragmatisme et la gestion opportuniste des affaires courantes. Mais le Comité Invisible refuse de conceptualiser ce rapport entre le réel et le possible, s’opposant à toute « dialectique entre le constituant et le constitué » [21]. Pour lui tout « projet de société alternatif » doit être récusé au motif que ce serait nécessairement un avatar de la stratégie de restauration du Pouvoir [22], avatar prophético-eschatologique de la terrible méthode luttant « au nom de… » un peuple, une classe, des valeurs, etc. Résultat « l’autre idée de la vie » est déhistoricisée, bloquée entre ciel et terre. De même concernant la « massification »-unification (échelles nationales et internationales) des communes, dès qu’il tente d’aller au-delà des métaphores du fourmillement contagieux, le texte se heurte à l’obstacle de la stricte égalité présupposée de ces insurrections multiples, aucune hiérarchie stratégique et tactique ne pouvant en être proposée : d’où une géographie de la révolution rabattue sur la contingence des « rencontres ». Bilan, ni dans l’espace ni dans le temps le vœu révolutionnaire, dès lors qu’il sort du bilan de la période et théorise le possible, n’aboutit à quelque chose de consistant pouvant réellement faire office de stratégie.
{{}}
Le Comité invisible contre la dialectique : la répétition scolastique d’un vieux préjugé postmoderne
En cohérence avec ses autres présupposés, A nos amis reconduit de façon récurrente l’antidialectique congénitale des Deleuze et Foucault depuis les années 60, mais qu’on trouve aussi dans divers (néo-)marxismes depuis plusieurs décennies qui ont troqué Spinoza contre Hegel avec plus ou moins de méthode [23]. L’héritage est évident lorsqu’est revendiquée la « logique de la stratégie » que Foucault opposait mécaniquement à une « logique de la dialectique » [24] d’autant plus facile à attaquer qu’elle était préalablement caricaturée : celle censée réduire tyranniquement-totalitairement, au plan théorique, le multiple à l’Un, et au plan pratique, l’aspiration à de nouvelles formes de vie à un modèle sclérosé et dominateur, par essence étatico-bureaucratique. Bref la dialectique d’un Hegel rétrospectivement stalinisé, dont les marxistes auraient usé et abusé.
Ce monstre théorique n’a pourtant rien à voir avec le sens des contradictions réelles au nom desquelles, Marx et Engels s’insurgeaient déjà contre les abstractions de ce genre, de même que Lénine et Trotsky, Luxembourg, contre les révisionnismes de la IIe Internationale puis des générations d’hétérodoxes contre le stalinissime Diamat, ont combattu sans trêve cette colonisation religieuse du futur qu’est « l’eschatologie » [25] également attaquée dans le texte. Or qui aujourd’hui défend encore une telle vision de la dialectique historique ? Il suffit de relire ceux qui sont restés marxistes dans l’école de Francfort (Benjamin, Marcuse) ou d’autres comme Sartre pour savoir que la lutte contre l’eschatologie a été au moins aussi plus profonde chez les marxistes eux-mêmes, que chez les Foucault, le « camarade Deleuze » comme dit le Comité Invisible, ou les situationnistes. A nos amis répète ici scolairement un préjugé qui était déjà vieux avant même de devenir un leitmotiv post-moderne, et qui n’a jamais fait l’objet de la moindre démonstration sérieuse depuis un demi-siècle. Ce fait est d’autant plus problématique, quoique révélateur, qu’il parcoure la trame de tous les autres impensés du livre.
{}
Entre un héritage antiautoritaire et la « vérité » contre la « démocratie »
A nos amis retombe alors de façon prévisible sur la revendication « anti-autoritaire » et antimarxiste classique, qui court depuis 1864 et le clivage Marx-Bakounine au sein de la Première Internationale jusqu’aux courants dits anarcho-autonomes des dernières décennies, dont parmi les dernières expressions, celle de Holloway (mâtiné de résidus négristes) est fort adéquate ici : « faire la révolution sans prendre le pouvoir ». D’où le refus attendu de toute organisation « institutionnelle » en quelque sens que ce soit (la forme-parti est par essence populiste et vouée à la bureaucratisation), au profit de la formule conspirative héritée de Blanqui, avec l’invisibilité comme tactique de contournement des appareils et de toute personnalisation du pouvoir, l’éthico-affinitaire comme critère de délimitation, et enfin l’antidémocratisme comme posture publique. « Le contraire de la démocratie, ce n’est pas la dictature, c’est la vérité » [26] lit-on. Comme le modèle des communes est modèle de vérité, on comprend que la « démocratie directe » des assemblées générales, par exemple, soit vouée aux gémonies en tant que théâtres populistes du petit pouvoir des « milieux » et des organisations, réformistes comme révolutionnaires, absolument obsolètes, ringardes et délétères, selon les auteurs de l’essai. Paradoxe certain, qui consiste à récuser les cadres démocratiques de ce type, quoiqu’imparfaits, des mouvements de lutte, au nom de l’antiautoritarisme. Bien sûr faut-il batailler en permanence contre leur bureaucratisation et leur instrumentalisation. Mais de là à les déserter ou les diaboliser, c’est-à-dire à abdiquer purement et simplement face aux difficultés réelles de l’autoorganisation réelle, il y a un fossé qu’aucun antiautoritaire conséquent ne saurait franchir.
« S’organiser n’a jamais voulu dire s’affilier à la même organisation. S’organiser, c’est agir d’après une perception commune, à quelque niveau que ce soit » [27]. Difficile d’avoir une idée plus abstraite – propice à n’importe quel contenu empirique, l’autonomisme se muant en justification de la pure contingence des « perceptions » – de ce que signifie s’organiser. Mais cette abstraction est « compensée » spéculativement, au plan de la théorisation de la subjectivité révolutionnaire, et d’une façon suffisamment percutante pour qu’on s’y attarde un peu.
3. Communes, formes de vie et « vérités éthiques » : l’opération subjective du livre
« Habiter pleinement »
« les insurrections contemporaines… ne partent plus d’idéologies politiques, mais de vérités éthiques. » [28]
« La logique de l’accroissement de puissance, voilà tout ce que l’on peut opposer à celle de la prise du pouvoir. Habiter pleinement, voilà tout ce que l’on peut opposer au paradigme du gouvernement. » [29]
Le contenu de ces « vérités éthiques » provient d’un faisceau de références, toutes compatibles avec la théorie foucaldo-agambenienne du biopouvoir, dessinant un anti-pouvoir fondé sur une autre idée de la vie (« bios »). Les auteurs proposent en modèle « la commune », « unité élémentaire de la réalité partisane » [30], comme forme de vie tout autant que forme d’organisation. Chaque incarnation de cette « forme » commune (dont les contours et le contenu ne sont volontairement jamais définis – sinon ce serait tomber dans l’abstraction tyrannique) est censée faire sécession et se réapproprier une zone emblématique en y déployant une forme de vie et un nouveau langage libres, une nouvelle façon d’être au monde, de le (ré)habiter pleinement – comme Heidegger le disait en révérant Hölderlin,il faut que l’homme « habite en poète ». L’infinité potentielle de ces communes-mondes libres prolongeant la charge nominaliste contre les entités « nature », « essence » humaine, « société » [31] ou encore « république », suspectes à la fois comme réalités, référents conceptuels ou idéaux revendicatifs. Pour le Comité Invisible, un monde se trouve « reconfiguré » quand y fait irruption une « vérité éthique », façon de (re)faire corps avec soi, les autres, et ce qui avant n’était que « l’environnement ». L’objectif de « l’accroissement de la puissance » d’être et d’agir (spirituellement, guerrièrement, matériellement), étant de pouvoir « s’assigner un bonheur difficile, mais immédiat »[32] formule conclusive du livre succédant à une référence de connivence à la formule très spinoziste d’un autre « ami », Nietzsche, selon laquelle le bonheur est « le sentiment que la puissance grandit ».
Des textes antérieurs avaient esquissé cette posture en se référant au « style », à la « possibilité existentielle » et « puissance d’affirmation » qu’était Blanqui [33]. Ici Spinoza semble avoir pris plus de place : joie et discipline nécessaires de l’auto-activation renvoyant à sa définition de l’être libre qui agit « selon la nécessité de sa nature » et « persévère dans son être » [34] en cultivant ces affects autorisant le désir, moteur de cette « nature » dynamique toujours sociale et historique qu’est le conatus, à s’accomplir contre les affects tristes qui, cependant, ne peuvent jamais faire disparaître – raison pour laquelle un monde purement pacifié est illusion. D’où la double charge contre les « pacifistes », au mieux naïfs mais en réalité complices, et les « radicaux » pour leur posture de salon, leurs « milieux » décomposés et leurs « entreprises groupusculaires » luttant pathétiquement, confondant calomnie et combat, puissance et pouvoir, pour « leurs minuscules parts de marché politique » [35].
{}
Amis ou camarades ?
{}
A nos amis est bien un nouvel appel, dont l’impact est réel idéologiquement comme politiquement (dérives jusqu’au-boutistes et minorisantes, agressives au besoin, incluses), depuis les luttes étudiantes anti-LRU en 2009 à la résistance à la politique austéritaire-autoritaire-meurtrière du gouvernement (à Toulouse et au Mirail en particulier), en passant par le mouvement contre la réforme des retraites en 2010. Quant aux conséquences médiatiques du fiasco policio-judiciaire de « l’affaire Tarnac », qui ont certes hypostasié son importance, elles ont en tous cas attesté que ce genre d’appel fait peur au pouvoir et que celui-ci est prêt à tout pour s’en prémunir.
{{}}
« L’affaire Tarnac »
Jean-Numa Lascar
L’affaire Tarnac est le nom de cette farce politico-médiatique qui commence officiellement le 11 novembre 2008, lorsqu’un groupe d’une dizaine de personnes se fait interpeller en divers endroits du territoire français au terme d’une véritable opération commando. Leur crime : l’« association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme », avec pour accusation principale le sabotage de lignes de TGV par la pose de crochets métalliques sur les caténaires. Ajoutée à cela la rédaction supposée d’un manifeste appelant à l’insurrection, L’insurrection qui vient, l’arrestation des Tarnacois (habitants du petit village corrézien de Tarnac) a tout de suite une portée politique. Un peu plus de deux ans après le mouvement contre le CPE, les services de renseignement émettent le risque de la « menace anarcho-autonome ».
L’affaire Tarnac, c’est la somme de six ans d’enquêtes, d’interrogatoires, de passages devant le juge, d’écoutes téléphoniques clandestines, de filatures burlesques, de perquisitions malheureuses, de recueil massif d’informations, d’échanges entre services d’espionnage et de l’infiltration d’un agent secret... C’est une suite de rebondissements qui amènent un à un à discréditer les menus éléments à charge contre les militants autonomes. L’affaire Tarnac, c’est l’exemple même de la partialité de la police, de la justice et des médias. De la rétention d’information à la création de faux témoignage, de l’acharnement des juges à l’emballement de la machine médiatique au début de l’affaire, c’est toute l’hypocrisie des différents appareils d’État qui se révèle, scandale après scandale. Après la clôture de l’instruction en avril dernier, la prochaine étape de l’affaire sera le jugement au tribunal de ce qui apparaît aujourd’hui, de l’avis même des médias dominants, comme un fiasco judiciaire.
{}
Mais la capacité de pénétration des idées du Comité invisible tient aussi, du côté de l’extrême-gauche révolutionnaire, à ce qu’elles n’ont rien de suffisamment solide en face : « l’ami » n’est-il pas l’évidente alternative au « camarade », terme le plus souvent considéré comme ringard ou vidé de son contenu aujourd’hui, expression subjective du fait que des « forces révolutionnaires assez confiantes en elles-mêmes » [36] n’existent plus ? « L’amitié » n’entend-elle pas précisément réincarner ce que la « camaraderie » ne signifie plus ? Concept politique d’une fraternité révolutionnaire caractérisée comme « faisant partie des joies blanquistes. Elle est cette forme rare d’affection où l’horizon du monde ne se perd pas ». Les amis « s’entr-appartiennent dans l’élément libre, c’est-à-dire qu’ils s’entr’appartiennent pour autant que chacun appartient toujours-déjà à un destin. ». Une société immonde ne s’oublie pas dans l’amitié, au contraire, voilà pourquoi « toute amitié est aujourd’hui de quelque manière en guerre avec l’ordre impérial, ou n’est qu’un mensonge ». [37]
Du côté des organisations d’extrême-gauche, trotskystes incluses, pour lesquelles A nos amis n’a pas de mots assez durs, l’heure n’est en effet pas au triomphe. Leur espace n’offre le plus souvent que le pitoyable spectacle du sectarisme ou de l’opportunisme et du suivisme à l’égard de la pseudo-gauche radicale plus ou moins mélenchonisée, c’est-à-dire réformiste, du bureaucratisme collaborationniste le plus crasseux au plan syndical. Rien, de fait, qui ressemble à une force à la fois intransigeante et enthousiasmante, capable de s’exprimer à la fois par une stratégie bien délimitée et une morale révolutionnaire définitivement délivrée des petitesses démocrate-bourgeoises. A la fin de Leur morale et la nôtre, Trotsky écrivait que sont bons et justifiés pour la révolution tous « les moyens qui accroissent la cohésion du prolétariat, lui insufflent dans l’âme une haine inextinguible de l’oppression, lui apprennent à mépriser la morale officielle et ses suiveurs démocrates, le pénètrent de la conscience de sa propre mission historique, augmentent son courage et son abnégation », et de conclure en disant que « les questions de morale révolutionnaire se confondent avec les questions de stratégie et de tactique révolutionnaire. L’expérience vivante du mouvement, éclairée par la théorie, leur donne la juste réponse. » C’est de là qu’il faut repartir.
On pourra s’accorder avec cette hypothèse du Comité Invisible sur
« la raison de l’échec, sans cela incompréhensible, de tous les "mouvements contre l’austérité" qui, alors qu’ils devraient dans les conditions actuelles embraser la plaine, en restent en Europe à leur dixième lancement poussif. C’est que la question de l’austérité n’est pas posée sur le terrain où elle se situe véritablement : celui d’un brutal désaccord éthique, d’un désaccord sur ce que c’est que vivre, que vivre bien… Ce qu’il faut, c’est plutôt assumer le véritable enjeu du conflit : une certaine idée protestante du bonheur – être travailleur, économe, sobre, honnête, diligent, tempérant, modeste, discret – veut s’imposer partout en Europe. Ce qu’il faut opposer aux plans d’austérité, c’est une autre idée de la vie. »[38]
Pourtant, il est radicalement faux de dire que les insurrections d’aujourd’hui « ne partent plus d’idéologies politiques... », comme si cela avait été jadis le cas. Ce n’est jamais le cas. Comme l’écrivait Trotsky dans la Préface de L’histoire de la révolution russe : « L’histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d’une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propres destinées… Les masses se mettent en révolution non point avec un plan tout fait de transformation sociale, mais dans l’âpre sentiment de ne pouvoir tolérer plus longtemps l’ancien régime. C’est seulement le milieu dirigeant de leur classe qui possède un programme politique, lequel a pourtant besoin d’être vérifié par les événements et approuvé par les masses. Le processus politique essentiel d’une révolution est précisément ceci que la classe prend conscience des problèmes posés par la crise sociale, et que les masses s’orientent activement d’après la méthode des approximations successives. » Le Comité Invisible fuit évidemment la confrontation à cette logique des « approximations successives », puisque cela impliquerait de regarder en face les défis de la transition révolutionnaire. Si on ne fait pas avancer concrètement la révolution avec de simples programmes minimum, jamais un programme maximum ne l’a non plus permis. Opposer avec cohérence une « autre idée de la vie » à des contre-réformes gouvernementalo-patronales suppose de déployer des modalités transitoires, formes d’organisation et d’auto-organisation comme revendications, permettant de transformer cette fin (cette autre vie à conquérir) en tâches capables d’impliquer progressivement des masses croissantes de personnes comprenant que les solutions minimales sont vouées à l’échec. Telle est la logique combinée du programme de transition et de la théorie-programme de la révolution permanente, au sein de laquelle ce sens des « vérités éthiques » radicales, de l’imaginaire vivant, de« l’utopie concrète » disait Marcuse, peuvent redevenir autre chose que des vœux pieux ou des moments éphémères, et redonner confiance, à une échelle populaire et pas affinitaire, en un communisme qui ne soit ni « sinistre » ni « de caserne » [39].
La tâche d’un marxisme de combat aujourd’hui, en l’espèce, est de démontrer théoriquement comme dans« l’expérience réelle du mouvement » que les véritables« amis » ce sont les camarades, et qu’il est théoriquement erroné et politiquement suicidaire de dire que « l’intelligence stratégique vient du cœur et non du cerveau » [40], aucun des deux n’étant capable, sans l’autre, d’œuvrer en révolutionnaire.
Références
[1] A nos amis, Paris, La Fabrique, 2014, p. 11-12. [ANA]
[2] Ibid. p. 72-73.
[3] Ibid. p. 92-93. IQV p. 115 disait la même chose mais de façon plus visiblement incohérente.
[4] Ibid. p. 91.
[5] L’insurrection qui vient, Paris, La Fabrique, 2007, p. 33-35 [IQV].
[6] ANA p. 120 rabat explicitement la valeur sur « l’expérience qu’elle offre au consommateur », c’est-à-dire en fait une composante essentiellement subjective et extra-productive, en l’espèce une variable consommationniste. Est aussi affirmé p. 82 que la monnaie est moins un instrument économique qu’une « réalité politique ».
[7] La classe ouvrière en France : mythes réalités. Pour une cartographie objective et subjective des forces prolétariennes contemporaines, Cahiers de Révolution Permanente, n° 2, mai 2014, parties I, II, et Annexe I « Production, circulation, réalisation, reproduction ».
[8] ANA p. 93.
[9] Ibid. p. 84.
[10] Ibid. p. 43.
[11] Ibid. p. 89.
[12] Ibid. p. 85.
[13] Sur l’exemple de l’appareil universitaire, cf. « Production des savoirs luttes de classes dans l’université du XXIe siècle », Partie I « La "marchandisation" des savoirs est-elle née avec le néolibéralisme ? », Révolution permanente, n°10, octobre 2013.
[14] ANA, p. 42-43.
[15] Ibid. p. 167.
[16] Cf. C. Tappeste,« Premier bilan de l’arrivée au pouvoir de Morales en Bolivie », Carré rouge, n° 35, mars 2006. Sur le développement récent d’une opposition de gauche à Morales, voir sur le site du CCR « La bureaucratie de la COB, obstacle pour la construction d’un véritable Parti des Travailleurs », 19/03/2013.
[17] Cf. Eduardo Molina, « Octubre como "Ensayo Revolucionario" », 2003, http://www.ips.org.ar/wp-content/uploads/2011/04/Octubre-como-Ensayo-Revolucionario.pdf ; C. Tappeste, « Bolivie. Guerres du gaz et lutte de classes à 4000 mètres au-dessus du niveau de la faim », Carré rouge, n° 33, juin 2005.
[18] Cf. « Quatorze thèses sur le printemps arabe », 04/06/11 ; C. Cinatti, « Trois scénarios pour les processus révolutionnaires arabes », 02/09/13.{}
[19] Refus plus explicite dans le texte apparenté E. Hazan Kamo, Premières mesures révolutionnaires, Paris, La Fabrique, 2013.
[20] Même si la formule n’est pas adéquate, en 2008 une intéressante critique de IQV parlait même de « catastrophisme » et d’« insurrectionnalisme messianique » : http://www.palim-psao.fr/article-34659700.html.
[21] ANA p. 73.
[22] Ibid. p. 76.
[23] Garo, Foucault, Deleuze, Althusser Marx. La politique dans la philosophie, Paris, Demopolis, 2011, chap. 2 et 3 ; E. Barot, « Marx "révélé" par Spinoza : l’enjeu politique d’une relecture », Contretemps, n° 21, Février 2008, p. 144-154.
[24] ANA p. 229.
[25] Ibid. p 21.
[26] Ibid. p. 64.
[27] Ibid. p. 17.
[28] Ibid. p. 43 et 45.
[29] Ibid. p. 166.
[30] IQV p. 107.
[31] ANA p. 123, 195.
[32] Ibid. p. 238-9.
[33] Maintenant il faut des armes, Paris, La Fabrique, 2006, (textes de Blanqui choisis et présentés par D. Le Nuz), « A un ami » (Préface d’« un des agents du Parti imaginaire »), p. 9 et 25.
[34] Cf. « À nos amis : l’insurrection spinoziste », http://pascontent.sedrati-dinet.net/index.php/post/2014/11/27/A-nos-amis-insurrection-spinoziste. Egalement, U. Palheta, « Les insurrections sont venues, pas la révolution… ». revue L’anticapitaliste, n° 60, décembre 2014 ; J. Confavreux, « Comité Invisible : La révolution au XXIe siècle », {}http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/291014/comite-invisible-la-revolution-au-xxie-siecle .
[35] ANA p. 237.
[36] Ibid. p. 13.
[37] Maintenant il faut des armes p. 19.
[38] ANA p. 52.
[39] Premières mesures révolutionnaires p. 21 et 25.
[40] ANA p. 16.