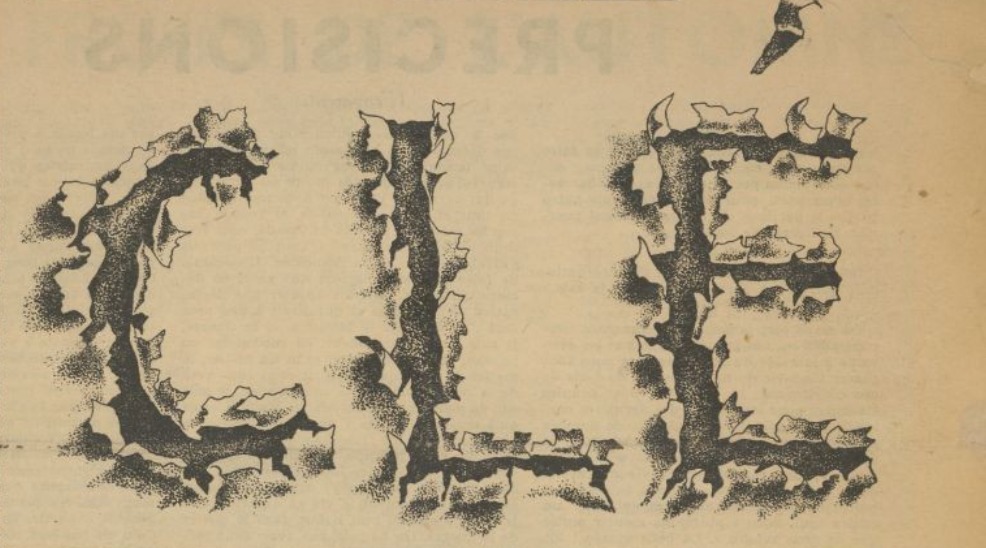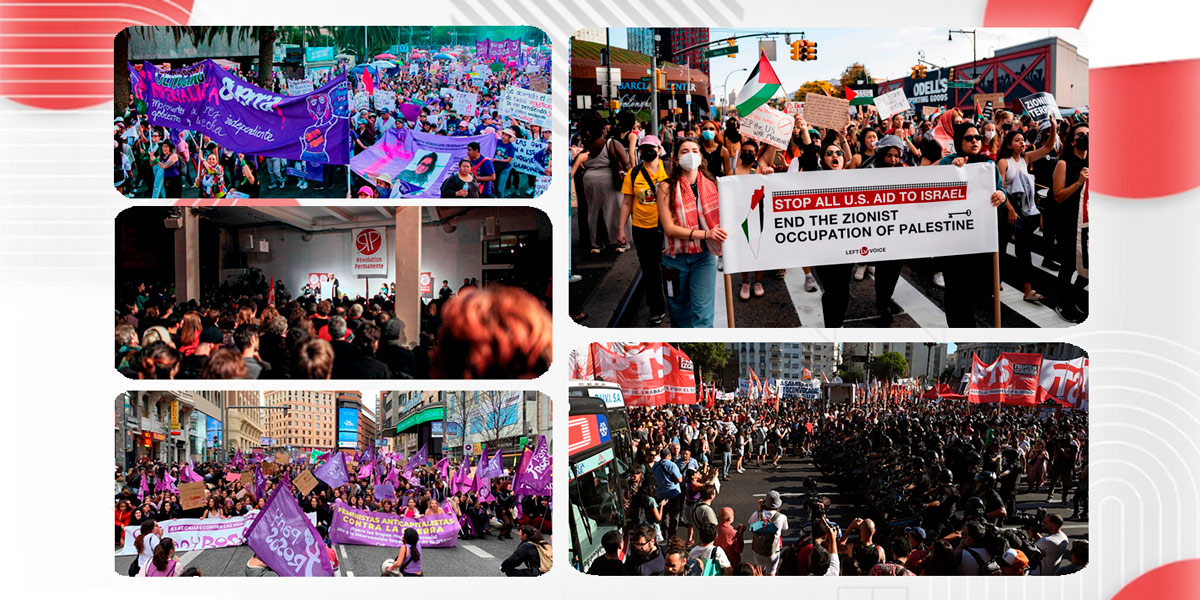Les deux auteurs, dans leur texte, avancent d’abord l’idée qu’il faut « former un tissu humain assez riche pour rendre obscène la bêtise régnante, et dérisoire l’idée que glisser une enveloppe dans une urne puisse constituer un geste - a fortiori un geste politique ». Certes, élections-pièges à cons, nous savons cela depuis pas mal de décennies maintenant. Un « tissu humain assez riche pour » ? En fin de texte, disent-ils « ramener sur terre et reprendre en main tout ce à quoi nos vies sont suspendues, et qui tend sans cesse à nous échapper. » Certes oui, à ce degré de généralité nous serons facilement d’accord. Mais nous y reviendrons, car la conclusion du texte, qui joue le rôle d’orientation « stratégique », est encore plus expressive : « Ce que nous préparons, ce n’est pas une prise d’assaut, mais un mouvement de soustraction continu, la destruction attentive, douce et méthodique de toute politique qui plane au-dessus du monde sensible. »
« Destituer » ?
Quid ? A très juste titre, toute sortes d’objections leur ont alors été faites, la plus importante étant, outre le caractère nébuleux des formules, l’absence totale de référence à la lutte des classes, à ce contre quoi il y a à se battre et s’organiser, ce à quoi il faudrait se « soustraire » – le pouvoir patronal, l’Etat bourgeois, les rapports de production capitalistes, les dominations et aliénations, d’où qu’elles viennent, mais que ceux-ci ont réorganisé autour de l’exploitation la plus brutale, etc. Frédéric Lordon de son côté avait répondu sur un mode plus prospectif, dans un article du Monde Diplomatique initulé « Pour la république sociale » que le « problème des mouvements destituants, cependant, est qu’ils se condamnent eux-mêmes à l’inanité s’ils ne se résolvent pas à l’idée qu’aux grandes échelles il n’y a de politique qu’instituée, ou réinstituée… C’est sans doute une ivresse particulière que de rester dans le suspens d’une sorte d’apesanteur politique, c’est-à-dire dans l’illusion d’une politique « horizontale » et affranchie de toute institution, mais si le mouvement ne revient pas sur terre à sa manière, c’est l’ordre établi qui se chargera de l’y ramener — et à la sienne. Mais alors, comment sortir de cette contradiction entre l’impossible prolongement du suspens « destituant »… et le fatal retour à l’écurie parlementaire ? »
La solution que proposait Lordon pour sortir de la contradiction n’est pas la nôtre, et nous l’avons déjà discutée (remettre au centre « cette institution qu’ils ont d’abord voulu contourner : la représentation » dit-il). Mais au moins il avait le mérite de poser un minimum le problème d’une politique alternative autant à l’électoralisme le plus crasse qu’à une telle antipolitique éthérée de la « destitution » reformulée de façon tout aussi nébuleuse dans l’interview du 13 juin : « La destitution… c’est d’ores et déjà cela qui est à l’œuvre depuis des mois dans chacune des rencontres, dans chacune des audaces qui font la vitalité de ce "mouvement". La question du jour d’après, de ce qui se passe ensuite, bref : l’angoisse des garanties, voilà bien ce qui n’a aucun sens dans l’actualité intégrale de la mêlée. ». Ou encore : « Nous l’avons appelé "destituant" en ce que, par sa simple existence et par ses interventions ponctuelles, il ruinerait pas à pas la faculté du gouvernement à gouverner. Cette mise en échec des stratégies gouvernementales successives, ramenées à de minuscules avortons de gestes, n’est-ce pas de cela que nous sommes témoins depuis plus de trois mois ? »
De quelle mise en échec parle-t-on exactement ? Bien sûr le gouvernement n’a pas eu, et n’a toujours pas la partie facile, et il le sait. Bien sûr les stratégies médiatiques, les institutions et la police en particulier, connaissent un discrédit grandissant. Et le tout dernier pas en arrière du gouvernement, revenant sur sa décision d’interdire la manifestation de ce 23 juin, est un épisode supplémentaire de sa perte croissante d’autorité. Mais, pourquoi donc alors, malgré cette faiblesse pathétique depuis plus de trois mois, n’avons-nous pas encore pu défaire Hollande et sa politique ? C’est de cela dont nous devons discuter, malgré ces difficultés croissantes du “gouvernement à gouverner” : la loi n’a pas encore été retirée. D’autre part, on ne peut laisser croire que ce sont les têtes de cortège dans les manifestations – les « interventions ponctuelles » ? –, qui ont à elles seules affaibli ou mis en difficulté le gouvernement. Bien sûr la réaction très combattive contre la répression, dans les manifestations, et le refus de baisser les yeux représente un changement énorme dans la situation politique. Mais si depuis début mai nous assistons à ce bras de fer très particulier entre le gouvernement et la CGT, si la mobilisation est encore d’actualité, malgré les éléments évidents de tassement qui caractérisent la situation, n’est-ce pas avant tout en raison du retour de la classe ouvrière sur la scène politique, au travers d’un processus de grèves dans certains secteurs stratégiques, et d’une combattivité grandissante là où personne ne l’attendait ?
Quand l’antipolitique vend du rêve à ceux qui cauchemardent debout
Ce genre de formules sur la « destitution » illustre ce que nous voulons entendre ici par « antipolitique » (terme qui n’a rien à voir avec « apolitique », parfaitement impropre en l’occurrence) : un type de politique qui hypertrophie sa forme pour masquer son absence de contenu, opposée à l’idée qu’on ne peut gagner – contre l’Etat bourgeois et toutes ses armes – sans chercher à convaincre une masse critique suffisante de celles et ceux qui luttent. Donc qu’il faut œuvrer à cela en s’organisant sur la durée sur la base d’un plan de bataille cohérent, précis, d’une part sans se laisser piloter, en dernière instance, par les figures, postures et organisations officielles notoirement réformistes (qu’elles soient assumées ou pas comme telles), d’autre part sans se vendre du rêve sur ce qu’on peut conquérir « ici et maintenant » ni sur les conditions dans lesquelles ce gouvernement pourra réellement être mis en échec.
Le combat, toujours en cours, contre la loi Travail et le passage étatique au stade industriel du matraquage, ou en d’autres termes, son saut bonapartiste, ont montré deux choses. D’abord, l’émergence d’un ras-le-bol, sur des bases politiques foncièrement anticapitalistes d’une frange croissante de la jeunesse, mais aussi de travailleurs, de précaires, qui en ont marre de se faire taper dessus et de devoir se contenter d’expédients pour survivre. Et qui ont tellement la rage qu’ils n’ont déjà plus peur de la répression, qu’ils sont prêts à l’affronter, et même à se préparer pour l’affronter plus encore. La politique ayant horreur du vide, les courants autonomes, très actifs dans les manifestations depuis plusieurs mois, ont effectivement compris cette réalité caractéristique de la période qui s’est ouverte : il y a un degré de combattivité nouveau dans ce pays, qui s’est déjà suffisamment enraciné pour constituer de puissants germes pour la suite des opérations, qui se traduit par la fin de la peur du flic, de la matraque, du canon à eau, et qui, dans la jeunesse mobilisée en particulier, s’enracine dans une aspiration de plus en plus profonde à une existence désaliénée, fraternelle, libérée de toutes ces ignobles chapes de plomb qui gangrènent le moindre petit élément du quotidien. Ce réveil de la combattivité est un fait marquant de ce printemps, et face à lui, il est très juste de dire que, aujourd’hui « Le gouvernement a peur » (mais ce n’est pas nouveau, quand plus largement les méthodes dures de la lutte des classes surgissent, elles le font très vite trembler : ne suffisait-il pas, à l’automne, d’une chemise arrachée pour le mettre en état d’alerte maximale ?), raison pour laquelle il ne se prive pas d’agiter le spectre de « l’ultra-gauche » radicalisée, dans la logique initiée par l’affaire Coupat-Tarnac – « mis en examen pour terrorisme » ainsi qu’il signe la tribune co-écrite avec Eric Hazan – et que dorénavant, la menace djihadiste-like du « terrorisme rouge » repointe son nez dans la « grande » presse.
Mais la seconde chose est justement ce qui fait de cette « invitation à destituer » une antipolitique, qui donne du cœur à l’ouvrage mais oublie de nourrir le cerveau, et s’incarne, entre autres, dans cette bataille fort ancienne entre autonomes et réformistes. Pas besoin de revenir ici sur le fait que les premiers, comme d’habitude, même si c’est à une échelle plus grande symptomatique de la situation, ont une nouvelle fois fait le plus souvent de l’affrontement direct avec les forces de répression le fin du fin. Bien sûr cet affrontement est structurellement en germe dans une société fondamentalement violente, société d’exploitation et d’oppression, et les passages à l’action directe ont historiquement toujours constitué une composante des luttes de la classe ouvrière contre la bourgeoisie et ses appareils d’Etat. Et du reste la confrontation avec la police est de fait comprise ou tacitement soutenue par des franges de plus en plus larges que ces seuls secteurs : l’ampleur de la répression a été telle ce printemps que le pacifisme et le légalisme sont apparus de plus en plus largement, et à raison, comme des mystifications, et l’auto-défense organisée, comme une nécessité : une seule manifestation parisienne suffit à affranchir le plus sceptique. Mais le fait de transformer trop souvent cette composante en tactique minorisante, s’auto-justifiant de façon illusoire en affirmant qu’élever ce niveau de confrontation aurait par soi un effet de radicalisation et de massification, de même que le rapport très incantatoire ou même hostile à l’auto-organisation la plus large dans les autres espaces de construction de la lutte, n’est pas le problème : il en est le symptôme. Le fond de l’affaire est surtout la confusion totale entre la nature de l’affrontement qu’il y a à construire avec le système et les fins servant de boussole, et les moyens de le construire, confusion induite par l’absence de la moindre vision un peu conséquente de ce que peut vouloir dire « destituer » concrètement, c’est-à-dire en termes de puissance matérielle des opprimés capable d’abattre la puissance matérielle de leurs oppresseurs.
Ce que signifierait déborder les bureaucraties par la gauche
Cette confusion incarne la formule la plus « radicale » du défaitisme : la période n’étant pas révolutionnaire, le degré de réaction étant si élevé, et les forces conciliatrices avec le système si prédominantes, ses défenseurs ne croient pas que la victoire est possible, et ne se donnent donc pas les moyens de la rendre possible. Même si sur des bases matérielles et sous des formes antagoniques, quelle différences de fond avec les réformistes et les bureaucrates, au bout du compte ? La logique de la « destitution », de la « destruction douce » (re-quid ?) qui se présente comme stratégie, n’en est pas une. Le fait de ne pas se donner pour perspective de convaincre les importants secteurs ouvriers qui, à la base de leurs syndicats, et en particulier de la CGT, ont poussé Martinez à devoir jouer le « contestataire » bien plus qu’il ne s’y prédisposait, en est une preuve éclatante. Coupat a raison, malgré quelques imprécisions factuelles (l’appel des 21 organisations de la jeunesse à joué un rôle clé dans la manifestation du 9 mars, indépendamment de tout le bruit généré en tout debut de mouvement par les pétitions en ligne et les réseaux sociaux, de dire, dans sa récente interview à Médiapart que « il ne faut jamais oublier que, depuis le 9 mars, les centrales ne font que suivre le mouvement. L’appel à manifester initial émanait de youtubeurs et d’une pétitionnaire. Les centrales s’y sont jointes parce qu’elles n’avaient pas le choix. Comme on dit à Nantes, "ce n’est pas la manifestation qui déborde, c’est le débordement qui manifeste" », et de pointer la coupure existante entre la direction de la CGT et une partie de sa base. Effectivement, Martinez a dû sous la pression aller plus loin qu’il ne l’anticipait dans l’affrontement avec le gouvernement. Mais il a réussi, pour l’essentiel, à le contrôler et lui donner sa physionomie, réalité à la fois cause et effet de l’absence d’un courant organisé du mouvement ouvrier capable de porter une alternative à sa politique de « pression in extremis » sur le gouvernement.
Or l’antipolitique autonome consiste à déserter la champ de bataille sur lequel se joue justement notre capacité à briser ce contrôle. Coupat va plus loin lorsqu’il dit, en s’appuyant sur les limites de l’horizontalisme citoyen de Nuit Debout : « … si monsieur Valls s’est chargé, avec son 49-3, de démontrer toute l’inanité de la démocratie représentative, les AG de Nuit debout place de la République ont donné à voir toute l’inanité de la démocratie directe. Ce que le Comité invisible disait dans À nos amis au sujet des assemblées générales, et qui paraissait si scandaleux il y a encore un an, est devenu une sagesse partagée, du moins par les esprits honnêtes. S’assembler, discourir puis voter n’est manifestement pas la forme par excellence de l’agir politique, c’est seulement sa forme parlementaire, c’est-à-dire la plus spectaculaire et certainement la plus fausse d’entre toutes. » Cette dernière phrase, aux antipodes d’une « sagesse honnête » convoquée ici comme d’autres convoquent « l’opinion publique » pour justifier leur politique en flattant le degré de conscience le plus bas, est l’expression la plus aboutie de la confortable (pour eux) et dangereuse (pour notre classe) confusion, que nous avons largement critiquée antérieurement, consistant à jeter le bébé avec l’eau du bain.
Condamner toute forme d’assemblée au motif que ce serait du « parlementarisme », donc aussi les formes de la démocratie ouvrière, du comité de grève à sa forme historiquement la plus élevée que furent les soviets (ou « conseils » ouvriers des révolutions russes et de la révolution hongroise de 1956, et auparavant le Comité Central de la Garde Nationale pendant la Commune de Paris), c’est purement et simplement laisser le champ libre et les pleins pouvoirs aux Martinez de toutes sortes. C’est refuser les cadres où les premiers intéressés peuvent prendre enfin les choses en main, sans laisser patrons, petits chefs, et bureaucrates décider à leur place. C’est refuser de chercher, dans ces cadres, à convaincre et donc à pouvoir élaborer et mettre en œuvre collectivement un programme de lutte et d’action alternatif, portant sur le retrait de la loi, mais posant aussi les jalons d’une lutte d’ensemble contre les conditions de travail, la précarisation, le chômage, incluant tout particulièrement les secteurs les plus exploités du prolétariat, les plus paupérisés, comme les jeunes des quartiers populaires.
Jamais la direction de la CGT ne s’est aventurée sur le terrain d’une telle lutte, bien consciente du fort potentiel révolutionnaire que celle-ci véhiculerait. Mais l’antipolitique autonome de l’insurrection-destitution ne s’y aventure pas non plus. Tout en s’affrontant d’un côté aux bandes armées de l’état, mais parfois physiquement aussi à cette bureaucratie, cette antipolitique ne propose pour autant pas la moindre alternative stratégique au réformisme. Elle lui laisse au contraire les coudées franches pour s’assurer encore et toujours le contrôle du mouvement ouvrier. Taper sur Melenchon, Tsipras, Podemos et Iglesias, et le grand cirque électoraliste, pas de problème. Mais proposer comme politique révolutionnaire alternative – “insurrectionnelle” – le pur et simple abandon du combat là où il permettra de construire le rapport de forces nécessaire pour faire tomber suffisamment les illusions que ce cirque véhicule, ne peut apparaître comme une solution que pour ceux qui ne veulent pas de révolution, et dans l’immédiat, ne se donnent nullement l’objectif de déborder les bureaucraties par la gauche.
Autonomes et réformistes, l’inlassable répétition d’un même cercle vicieux
Francis Dupuis-Déri, professeur de sciences politiques à l’université de Montréal, et notamment directeur d’un ouvrage très instructif en 2013 À qui la rue ? Répression policière et mouvements sociaux, rappelle dans son livre de 2003 Les Blacks blocs (nouvelle édition prévue fin 2016) que les courants « autonomes » s’inscrivent dans la tradition de l’anarchisme et de l’action directe, entendue comme réponse pouvant prendre de multiples formes, soit défensives, soit offensives, pouvant aller du simple sabotage jusqu’à la lutte par les armes, contre cette violence sans bornes du capitalisme et de son Etat. Dupuis-Déri rappelle cependant que « l’anarchisme » n’est pas homogène sur cette question de la contre-violence politique, des conditions dans lesquelles elle est légitime et utile, et son analyse des black blocs met en lumière la même diversité. A quoi il faut ajouter, élément absent du livre, que ces courants autonomes se diversifient aussi selon qu’ils ont hérité ou non de la tradition de l’autonomie ouvrière, laquelle cherchait à combiner radicalité de l’action directe avec mobilisations larges des prolétaires, que ce soit les grèves et occupations d’usines (à l’image de l’automne chaud à la Fiat du Turin en 1969) ou les actions de rue, en rupture avec les bureaucraties syndicales. Ce n’est pas cette tradition là qui nous occupe présentement.
Ce qui est surtout instructif ici, Dupuis-Déri le rappelle à de nombreuses reprises, est que la tactique des black blocs a pour terreau leur condamnation de la collaboration des réformistes et bureaucrates avec le pouvoir : « C’est précisément parce qu’ils réduisent en grande partie l’efficacité du mouvement altermondialiste à sa capacité éventuelle de permettre à des "représentants" du mouvement de participer aux processus officiels de prise de décision au sein des institutions gérant la mondialisation économique que des dirigeants d’organisations sont enclins à condamner les black blocs », et bien sûr, réciproquement, c’est pour la même raison que ceux-ci condamnent ceux-là et optent pour leurs options radicales, se vivant, « dans un contexte qui n’est pas révolutionnaire… comme les veilleurs qui guettent l’arrivée d’un nouveau monde mais qui, en attenant, jouent des coudes dans le monde actuel pour dégager plus d’espace de liberté, d’égalité et de justice » (p. 72)
Dans la rue, il est classique que les Black Blocs refusent de s’associer à des services d’ordres qui pactisent avec la police, ceux-ci les qualifiant en retour de voyous et de casseurs, et réciproquement, et les échauffourées ponctuelles tout à fait inévitables. Comme le rappelle Isabelle Sommier dans une interview tout à fait instructive, « l’hostilité est intrinsèque entre les syndicats et ce qu’ils appellent les casseurs (gauchistes dans les années 1968, autonomes à la fin des années 1970). Des affrontements violents ont eu lieu avec le SO de la CGT lors de la manifestation des sidérurgistes du 23 mars 1979 ; les autonomes étant même accusés d’être manipulés par la police – on retrouvera cette dénonciation en 2006. Leurs représentations et leurs usages de la manifestation sont diamétralement opposés ; la manifestation s’est progressivement distinguée de l’émeute par son organisation et sa pacification à partir de la fin du XIXe siècle, dont les services d’ordre syndicaux se veulent garants. Pour l’ultragauche en revanche, elle doit être l’occasion d’exprimer librement, sans contraintes, sa colère et sa révolte. De façon significative par exemple, à l’occasion de la manifestation du 17 mars dernier, le MILI en appelait à une "émeute dans Paris" ».
Entre les deux ? Ce qui est frappant dans le livre de Dupuis-Déri, c’est le fait qu’à aucun moment il ne confronte la « stratégie » autonome, pourtant abondamment mise en opposition avec le réformisme et le bureaucratisme syndical, avec la stratégie marxiste révolutionnaire, à peine évoquée indirectement dans une note expéditive. Cette absence n’est pas seulement une faiblesse énorme, c’est surtout le reflet d’une réalité : concrètement, les 20 dernières années, et lors de tout le mouvement anti-guerre, puis altermondialiste, et enfin des indignés, n’ont pas vu l’émergence, dans la lutte des classes, d’une politique révolutionnaire capable d’apparaître comme une alternative claire et conséquente jusqu’au bout face aux réformistes. De fait la mobilisation contre la loi travail n’a pas fait exception à cette situation de crise des forces révolutionnaires, et le poids conjoncturel qu’a pris l’antipolitique autonome ce printemps n’est en ce sens que le reflet, la contrepartie de l’inexistence à échelle de masse d’une telle « troisième voie » capable de concilier radicalité et massification par l’auto-organisation, pensée à l’aune d’une hypothèse stratégique tournée vers la révolution et non conciliatrice avec les bureaucrates. Le défi est sans conteste de faire émerger cette voie, si nous voulons réellement arriver à « destituer » quelque chose.
Quand l’exaltation retombera
Il est évident que faire émerger cette voie interdit, d’autre part, de repousser aux calendes grecques le processus de rupture subjective avec l’ensemble des traces du système en nous : l’individualisme, l’égoïsme profonds, bien sûr, mais aussi tout ce par quoi nous reproduisons, même parfois sans le vouloir, ce que nous avons en haine, comportements paternalistes et sexistes, racistes même, pourquoi pas. Et à l’échelle collective, à un certain nombre d’égards, il est évident que la forme et le contenu de la lutte qu’on mène aujourd’hui préfigurent la forme et le contenu, si nous sommes victorieux, de ce que nous instituerons demain. Mais peut-on croire réellement s’affranchir totalement, ici et maintenant ou presque, de ce qui existe ici et maintenant ? La fraternité de combat - et son "tissu humain riche" - d’aujourd’hui préfigure la fraternité d’une société libre, sans classes, sans Etat organisée rationnellement par les producteurs-trices associé-e-s – le communisme. Toute l’histoire de la solidarité ouvrière en est porteuse. Mais on n’exerce jamais sa liberté, individuellement comme collectivement, dans une société répressive, sans porter les stigmates de cette dernière et tous les cadres et organisations dont on peut se doter pour mener la lutte, au sein d’un mouvement de lutte conjoncturel, ou dans la durée, ne peuvent échapper à ces limites. N’importe quelle organisation peut dégénérer, se bureaucratiser, développer toutes sortes de pathologies, et l’histoire du mouvement ouvrier est jonché de ces dégénérescences, toutes liées de près ou de loin, quelles que soient les formes prises, à l’abandon du projet révolutionnaire entendu comme projet d’auto-émancipation historique de l’humanité exploitée et opprimée – le stalinisme ayant été jusqu’ici la pire de toutes.
Mais on ne lutte pas correctement contre un risque de cette nature en… refusant de l’affronter. La principale arme contre la bureaucratisation et la manipulation, c’est justement l’auto-organisation et l’ensemble des formes de démocratie révolutionnaire qu’elle peut recouvrir, et qu’il y à reconstruire aujourd’hui. Quant aux idées d’organisation ou de parti révolutionnaires, rien d’étonnant à ce qu’elles aient suscité tant de désaffection depuis plusieurs décennies : les casseroles historiques qu’elles ont aux fesses sont encore bien lourdes et bruyantes. Mais ériger en vérité éternelle une réalité historique spécifique (dire par exemple que la « forme-parti » serait « en soi » porteuse « d’autoritarisme » et serait un « obstacle à la liberté » individuelle de penser, etc. etc.) n’a jamais été – sinon dans la pensée bourgeoise – une méthode sérieuse d’analyse et de règlement des problèmes, celle-ci, en dernière instance, renvoyant à la question de la stratégie à formuler et armer contre l’adversaire.
Trotsky liait ces questions de la façon suivante : « Un parti est un organisme actif. Il se développe au cours d’une lutte contre des obstacles extérieurs et des contradictions internes. La décomposition maligne de la II° et de la III° Internationale, dans les sévères conditions de l’époque impérialiste, crée pour la IV° Internationale des difficultés sans précédent dans l’Histoire. On ne peut les surmonter par une quelconque formule magique. Le régime d’un parti ne tombe pas tout cuit du ciel, mais se constitue progressivement au cours de la lutte. Une ligne politique prime sur le régime. Il faut d’abord définir correctement les problèmes stratégiques et les méthodes tactiques afin de pouvoir les résoudre. Les formes d’organisation devraient correspondre à la stratégie et à la tactique. Seule une politique juste peut garantir un régime sain dans le parti. »
L’antipolitique autonome ne propose pas de stratégie, brandit une vision étroite et confortable de ce que « s’organiser » veut dire, et compense en exaltant de façon populiste un type de subjectivité et de modalité d’engagement tout à fait séduisante sur le papier ou conjoncturellement, mais aux antipodes de l’endurance, de la profondeur et de la lucidité requises. Beaucoup se retrouveront bientôt orphelins de perspectives lorsque l’heure ne sera plus à l’exaltation des têtes de manifestations, aux « audaces » ponctuelles, et qu’ils seront lassés de ces sympathiques « rencontres » sans lendemain politique. Pourtant la lutte de classe en France vient d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, et la période qui s’ouvre va être très vraisemblablement propice à un degré conflictualité sociale comme on ne l’a pas connu depuis longtemps. La capacité d’agir politiquement dans ces nouvelles coordonnées, d’une façon qui fasse la différence, dépendra beaucoup de notre capacité à comprendre combien, et jusqu’où, les questions de stratégie, d’organisation, et de subjectivité révolutionnaires sont organiquement liées.
En particulier, une morale révolutionnaire concrète pour des temps réactionnaires ne pourra pas sauter par-dessus l’histoire : son accomplissement effectif, dans les luttes et leurs cadres, dans les organisations, partout, l’exige en réalité à l’échelle de toute la société. Rompre vraiment avec la morale autant que les chiens de garde de la bourgeoisie, suppose d’abattre la société bourgeoise. Ce qui nous ramène à nos tâches immédiates : batailler conjointement sur les terrains stratégique, tactique, organisationnel et subjectif, dans le sens des fins que l’on a choisi, pour passer méthodiquement, en assumant les difficultés au lieu de les éviter, et pas illusoirement, du rêve à la réalité. Il faut du courage pour s’affronter aux forces de répression, et les autonomes n’en manquent pas. Mais il en faut encore bien plus, au-delà, pour s’affronter scientifiquement à ce dont elles sont le bras armé. Tel est la substance du marxisme révolutionnaire porté depuis, au moins, le Manifeste et la révolution de 1848. Julien Coupat termine son interview en citant une phrase latine que Marx – « l’autre » comme il dit –, reprenait à Hegel au début du 18 Brumaire : « Hic Rhodus, Hic salta ! », qui sur le fond veut essentiellement dire « C’est le moment de montrer ce dont tu es capable ». Citer Marx, c’est bien, d’ailleurs même Jacques Attali et le Wall Street Journal l’on fait. Mais le relire sérieusement serait encore mieux.