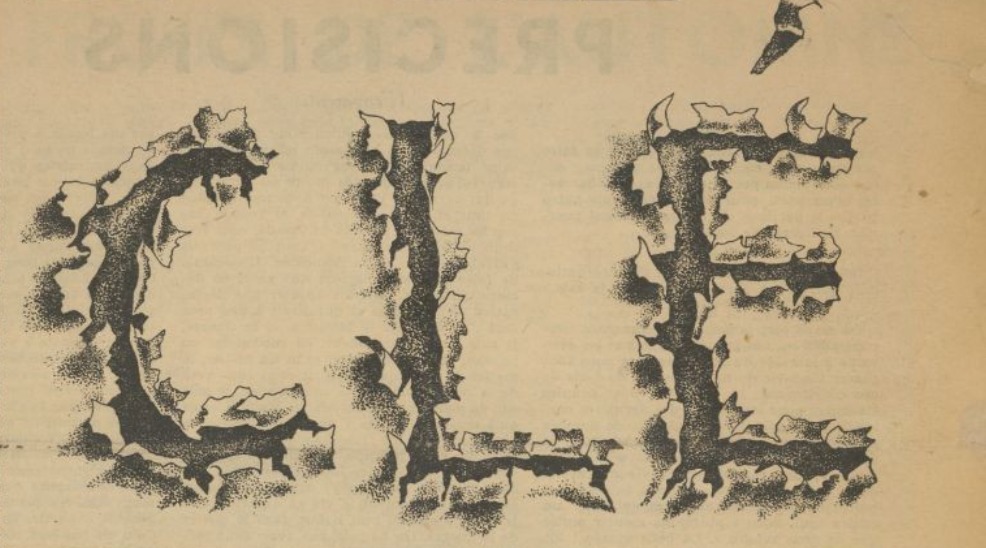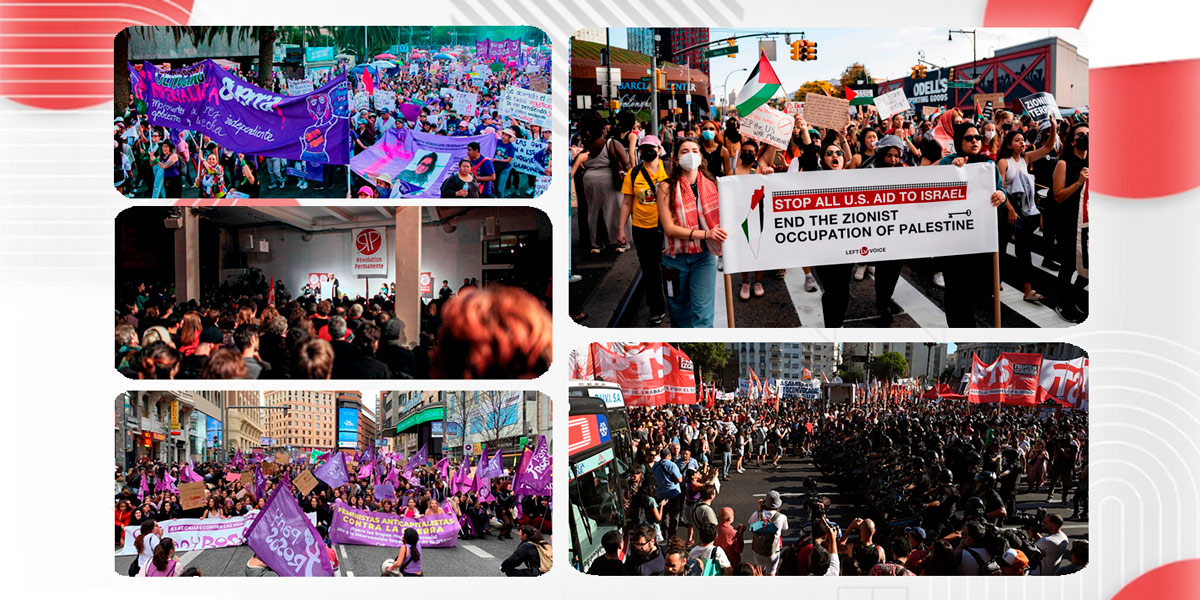Dans le recueil Vie précaire publié en anglais en 2004, J. Butler réfléchit sur la vulnérabilité de la vie et le pouvoir du deuil à l’époque de la terreur inaugurée par l’expérience du 11 septembre 2001. A la lumière des événements récents sur le phénomène, on peut s’interroger sur ce qui se manifeste après les attentats des 7 et 9 janvier 2015, du 13 novembre 2015 et du 22 mars 2016 et confirmé par la tuerie d’Orlando il y a quelques jours, d’un apparent dépassement des antagonismes politiques à travers l’expérience du terrorisme. En effet, de façon feinte ou sincère, le deuil consécutif à une agression qualifiée de terroriste rassemble, dans un consensus généralisé auquel l’opinion se garde de chercher les (nombreux) poux.
S’appuyant sur les critiques déjà formulées par Judith Butler qui entend discerner les logiques sous-tendues par le terrorisme et les façons dont il est perçu, il s’agirait de revenir sur l’effacement de ses conditions d’émergence tout autant que sur la menace qu’il constitue pour l’hégémonie occidentale. Pour dépasser la vision polarisée du monde qui en découlerait selon nos dirigeants, il convient d’enlever un peu du mysticisme qui entoure ce qu’on qualifie de terrorisme. Pour cela, il faut replacer ce phénomène dans une histoire mondiale, en pointant du doigt la responsabilité des politiques impérialistes et interventionnistes des pays qui sont, désormais, les cibles d’attentats, et qui entraînent dans leur sillon bien d’autres pays dits « périphériques », à l’image du Liban dont l’attentat de janvier 2015 a été largement exclu de cette « communion » internationale, dans cette tourmente.
Qu’est-ce que le terrorisme ?
Si cette question, jamais posée par les médias dominants, paraît simpliste, c’est que la notion même de terrorisme repose sur le socle de l’évidence. En effet, elle s’appuie sur un ensemble de prérequis qui, comme beaucoup de donnés politiques – la loi, la démocratie, la sécurité… –, en masquent l’arbitraire.
En premier lieu, le terrorisme se distingue de la guerre : il ne s’agit pas, a priori – et naïvement – d’un phénomène lié à un conflit rangé entre deux États, mais d’actes inqualifiables et insituables qui dérogent à l’art de la guerre et s’en excluent du même coup. En fait, ce n’est pas tant la nature du terrorisme, son modus operandi, qui le distingue d’actes militaires – après tout, une armée ne se définit pas à son uniforme – que son apparente gratuité. Un attentat n’est pas une bataille : il se présente – nous est présenté – comme un fait singulier, brutal, et radicalement unilatéral. Le terrorisme est sans fondement : c’est à la fois pourquoi, et parce que, il se vit sur le mode du sentiment, de la terreur inscrite dans son nom.
La violence de l’acte, moralement inacceptable, crée le tabou qui bride toute tentative de généalogie du terrorisme. Le terme masque la chaîne de causalité, la recouvre et l’abolit pour devenir le temps zéro de l’agression, le début des hostilités, écartant, du même fait et tout aussi radicalement, la possibilité de comprendre, rationnellement, les déterminations successives dont l’acte terroriste est l’aboutissement.
« Expliquer, c’est déjà excuser » : que l’on attribue cette phrase à Valls, Sarkozy, Bush ou tout autre dirigeant prononçant, par cette sentence presque obscène, l’interdiction de tout travail sociologique ou généalogique, son sens demeure le même. Comprendre, c’est accepter une part de culpabilité que l’opinion dominante n’est pas prête à entendre, ou maintenue en : le terrorisme doit rester sans fondement pour que la violence reste l’apanage de l’autre. L’enjeu, c’est la monstruosité de l’agresseur : déshumanisé, celui-ci perd, en même temps que son appartenance au genre humain, son droit à la vie. La vengeance devient possible, l’agression en retour nécessaire : « nous ne considérons pas nos propres actes comme des actes terroristes », écrit Butler, parce que nous nous octroyons le privilège de la violence légitime.
Deuil et déni du deuil : le barbare et le civilisé
Il convient ici de remarquer que cette terreur soigneusement entretenue engendre un traumatisme : celui-ci rend possible une « stratégie du choc », selon les termes de Naomi Klein qui observe que tout traumatisme est suivi d’une perte temporaire de la capacité de juger, qui amène l’individu (et les masses) à consentir sans broncher aux directives qui lui sont données alors. Le climat est donc propice à l’instauration de politiques sécuritaires, lois sur le renseignement bafouant notre droit à une vie privée ou état d’urgence entravant nos libertés individuelles et collectives : « panique généralisée, consolidation de l’État souverain et suspension des libertés civiles vont de pair », analyse Butler.
Ce climat est également favorable à un repli sur soi des peuples, nations, ethnies ou communautés touchées par le traumatisme : alors que, pour Butler, le terrorisme nous ouvre à l’expérience, commune, du deuil, notre réflexe collectif est de repousser l’Autre, s’en protéger et, plus souvent encore, l’agresser en retour.
C’est là où se produit la polarisation, « moi versus l’autre », qui contraint l’opinion à un dilemme à la Bush – « vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous », c’est-à-dire avec les terroristes. Cette transformation manichéenne du monde n’est rien de moins que la division antique entre la civilisation et la barbarie : c’est une distinction produite à partir d’un centre – pourquoi pas le nombril du monde – à propos d’une périphérie définie négativement. Après tout, le barbare – étymologique – est celui qui ne parle pas grec ! L’image du barbare se résout pour l’heure dans la figure de l’islam, -iste ou -ique – voire par extension, du musulman, rejeté par assimilation avec une figure étrangère menaçante.
La problématique à laquelle Butler rattache ce phénomène de polarisation est la reconnaissance, laquelle se dévoile dans la gestion politique du deuil. « Quelle vie est jugée digne d’être vécue, quelle mort d’être pleurée ? ». Seules les vies qui sont reconnues comme telles, comme des vies humaines, ont le droit au deuil : le cadre qui définit telle ou telle vie ou mort comme légitime, en lui accordant une visibilité, définit aussi négativement celles qui sont illégitimes. Il n’y a pas de nécrologie des victimes des Etats-Unis, ni de celles de la France ; ce sont des vies sans visage et sans nom, donc sans reconnaissance et sans deuil. De même, les victimes de Daesh sur « son » territoire – Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Mali… – n’émeuvent guère l’Occident : ces vies civiles, non reconnues, sont montrées comme des masses anonymes et accessoires.
Le corollaire de cela, bien sûr, est que c’est la non-reconnaissance des vies « terroristes », « barbares » ou « islamistes », voire même des milliers de victimes de cette guerre au quotidien dans la région moyen-orientale depuis la barbarie du régime d’Assad jusqu’aux bombes occidentales, qui fait passer leurs actes pour gratuits : ce qui n’est pas perçu, ni perceptible, comme une agression – par exemple les frappes aériennes en Syrie – ne peut pas donner lieu à des représailles, faisant à nouveau de l’acte terroriste le temps zéro de l’agression.
L’hégémonie menacée
Ce qui a été perdu le 11 septembre, selon Butler, c’est « la prérogative d’être, encore et toujours, les seuls à violer les frontières souveraines des autres Etats, sans jamais se retrouver en position de subir soi-même cette violation ». L’illusion arrogante de la toute-puissance des Etats-Unis a été perdue : ils ont vécu l’expérience tragique de leur propre vulnérabilité.
Si tout le monde a peur du terrorisme, c’est qu’il nous révèle à notre vulnérabilité ; brutal, toujours inattendu, inévitable, il nous ramène à notre impuissance. Personne n’aime se sentir vulnérable. En quelque sorte, le sentiment d’invulnérabilité se déguisait en droit et justifiait que l’on laisse se commettre des violences impunément envers ceux qui nous étaient vulnérables ; mais le choc de la remise en question, loin de faire cesser cette violence dont on ne peut ignorer qu’elle escaladera, transforme les motifs de la violence. La haine, la colère, le désir forcené de sécurité et de vengeance, la pulsion destructrice envers l’étranger auquel on ferme à tout prix ses frontières : tel est le visage de la guerre transfiguré par l’acte terroriste originaire. Les Etats, dans cette position, ne sont guère différents du loup blessé qui mord en retour, quitte à laisser béantes des plaies qui finiront par le tuer. Quitte à s’exposer à de nouvelles blessures. Quand la force d’une grande puissance est remise en question, son réflexe immédiat est de la réaffirmer. La violence suit la violence, indépendamment d’un processus d’explication et de généalogie, gelé par la polarisation médiatique entre « eux » et « nous », les méchants et les bons. La fin de la guerre n’est pas la paix : c’est la vengeance. Jusqu’à l’éradication de l’Autre.
L’impérialisme, terreau fertile de la violence
Ben Laden a été créé à partir de « l’une des côtes d’un monde dévasté par la politique étrangère américaine », écrit l’écrivaine indienne Arundhati Roy. L’impérialisme étatsunien – mais pas seulement, l’Europe n’est pas de reste et la France moins encore – produit les conditions d’émergence d’une violence épidermique et radicale à l’encontre de ces mêmes puissances et de leurs symboles. Omar Mateen est un citoyen américain, élevé aux Etats-Unis, et c’est dans son sein qu’il commet un massacre de l’intérieur, avec des armes légales et un permis américain. Le terrorisme n’est jamais radicalement extérieur aux pays qu’il touche, bien au contraire. Les tireurs du Bataclan sont français, et les allers-retours France-Syrie accomplis par de nombreux jeunes montrent assez que le terrorisme qui sévit en Europe use de ses citoyens. Il est aussi vain de vouloir faire rentrer le terrorisme dans une dichotomie eux-nous que de vouloir déchoir de leur nationalité les français qui se retournent contre « nous ».
Il n’y a pas de distinction radicale ; il n’y a pas d’innocence. « Nous sommes en guerre », assénait Hollande chef des armées, c’est vrai. Et c’est nous qui avons commencé. Là encore, le fameux refus d’une généalogie est à l’œuvre. Dans un formidable « c’est celui qui l’a dit qui l’est », nous assistons à un « refus nationaliste de reconnaître les critiques émanant d’autres parties du monde » pour reprendre les mots de Butler, à une déresponsabilisation radicale de nos Etats. Pourtant, le terrorisme n’est pas hors de l’histoire ; au contraire, il est en plein dedans. Il ne sort pas de nulle part, mais émerge de conditions jetées par l’impérialisme américano-européen. Il s’agit de « repenser la relation entre les conditions et les actes », préconise Butler.
Bien sûr, cela ne revient pas à annuler la responsabilité individuelle. Dire que l’impérialisme produit des conditions propices à l’émergence de revendications violentes et d’actes terroristes ne revient pas à faire de celui-là un déterminisme absolu : il ne s’agit pas de dire que l’impérialisme produit mécaniquement des terroristes, ce qui effacerait à tort la responsabilité individuelle, ni que cet horizon deviendrait une destinée nécessaire pour quiconque s’opposerait à l’impérialisme occidental, mais de souligner les conditions matérielles qui ont largement contribué au développement d’individus et d’idéologies qui ont abouti à des actes que l’on qualifie de terroristes. Face à l’impérialisme, l’opposition n’est pas simplement l’affaire de choix individuels de djihadistes, mais bien plutôt d’une culture et d’une politique du djihadisme comme phénomène collectif. Daesh ne se réduit pas à une question de responsabilité individuelle : c’est une machine sociale, économique, politique, culturelle puissante qui propage, en effet, le culte de la terreur.
La réponse à la question « pourquoi avons-nous tous peur du terrorisme ? » est en vérité multiple. Manipulations médiatiques, expérience de sa vulnérabilité, incompréhension ou inconscience de son propre impérialisme sont autant de raisons de le craindre, et de motifs d’une union factice face à ce phénomène qui gomme efficacement toutes dissensions disgracieuses.
Ne nous leurrons pas cependant : le terrorisme est un des symptômes d’un système pathologique. Il n’a rien d’inattendu, et n’aura plus rien d’exceptionnel sans doute : ce n’est qu’un monstre de plus engendré par l’impérialisme occidental.