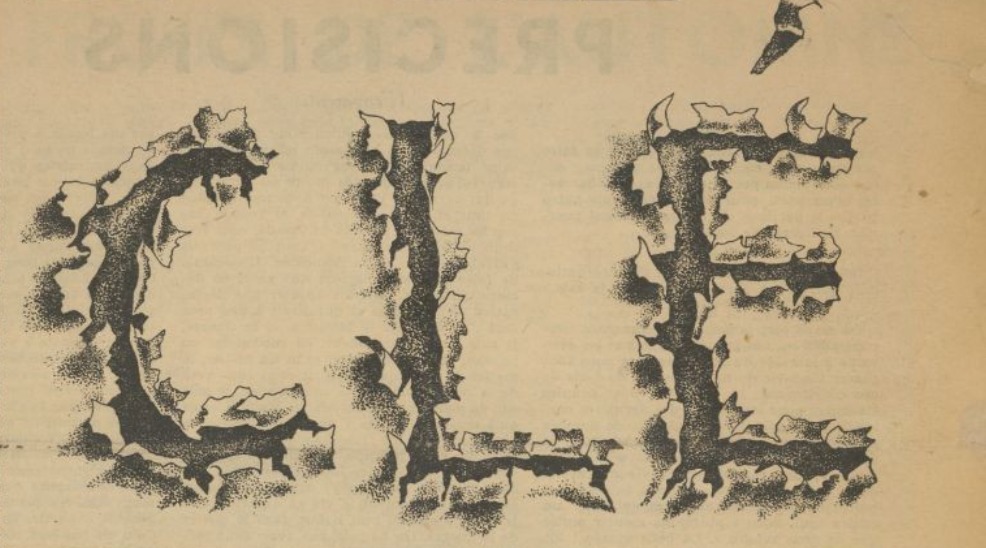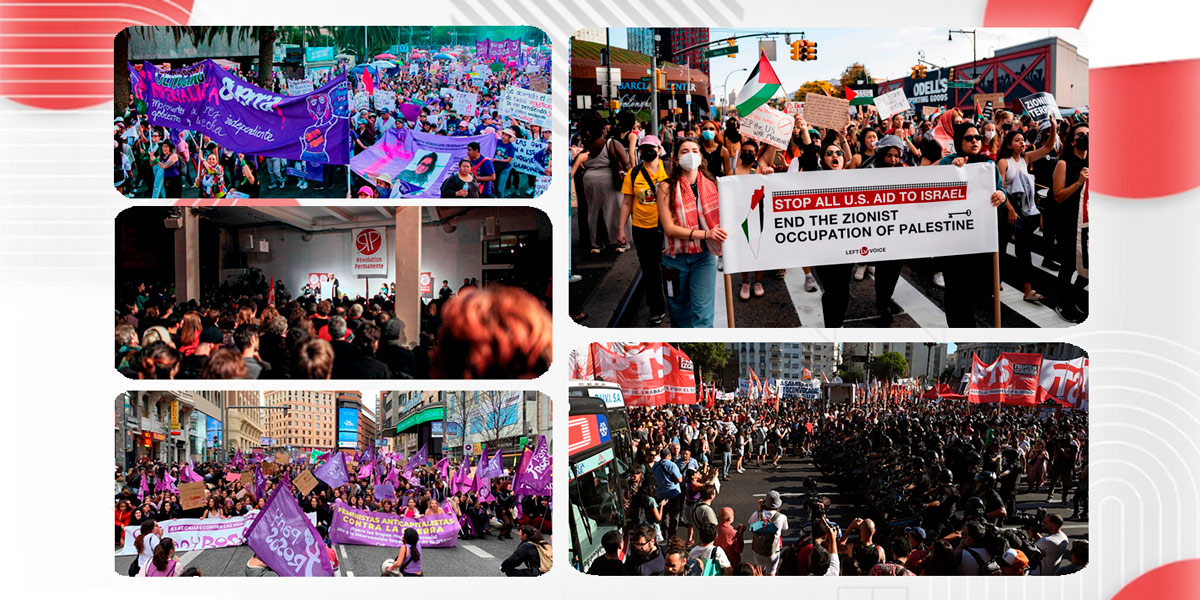Article original : La Izquierda Diario
Un fait strictement « exogène » à l’économie, mais pas à la manière spécifique avec laquelle le capitalisme développe les forces productives. Nous faisons ici référence au mépris de la nature caractéristique de l’agrobusiness depuis des décennies, au processus persistant de destruction du système de santé publique typique du néolibéralisme, au dédain pour la recherche épidémiologique et à la sourde-oreille faite face aux alertes sur les possibilités d’épidémie de nouveaux coronavirus pouvant affecter les humains. La deuxième force : la faiblesse héritée de la reprise économique post-crise 2008-2009. Une fragilité qui s’exprime depuis plus d’une décennie dans deux groupes de facteurs qui, comme on le verra, sont complémentaires. D’un côté, la lente croissance du commerce mondial – une tendance bien antérieure aux mesures protectionnistes de Trump –, de l’investissement dans le capital fixe et de la productivité du travail – malgré le fort développement des nouvelles technologies. De l’autre côté, la rapide croissance des dettes privées comme publiques.
La pandémie, de son côté, agit comme une sorte de substance paralysante qui s’étend par les canaux de la mondialisation, presque comme une sorte de « vengeance du destin ». Le manque de préparation sanitaire a exigé d’arrêter l’économie – et en particulier le flux international des personnes et des marchandises – par peur d’un effondrement des systèmes de santé, d’une catastrophe humanitaire et de la perte de contrôle de la part des États. La paralysie secoue l’ensemble des économies mais frappe avec une virulence particulière les secteurs les plus internationalisés : les chaînes globales de valeur – propres notamment aux entreprises électroniques, automobiles et chimiques – d’une part, et les secteurs des services comme le tourisme, l’aviation, la restauration et la gastronomie, de l’autre. Le quasi-gel de l’économie se répercute naturellement sur le secteur pétrolier, victime à son tour de la concurrence internationale aiguë entre l’Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis.
Ce qui a été dit jusqu’à maintenant, en guise d’introduction, illustre une partie de la dynamique actuelle mais tient déjà, dans un certain sens, du passé. Ce que nous voulons particulièrement traiter ici est la manière par laquelle ces différents éléments sont entrelacés et interagissent avec les faiblesses laissées par l’autre « force », c’est-à-dire par les conditions économiques post-Lehman Brothers. En d’autres termes, nous souhaitons aborder les dynamiques que peut suivre la crise à partir de leurs noyaux critiques, tout en soulignant de la manière la plus claire possible les grandes questions et contradictions qui jalonneront l’avenir.
Dettes des entreprises : le maillon faible
Une coïncidence criante existe entre les secteurs de l’économie qui sont les plus touchés par le choc pandémique et les dettes privées non financières. Il faut se rappeler qu’à la différence de la crise de 2008-2009, la plus grande partie de la dette du secteur privé ne se trouve pas actuellement concentrée dans les crédits immobiliers et hypothécaires, mais dans les crédits des entreprises. Comme en témoigne un article du Financial Times se basant sur les chiffres de l’OCDE, pendant toute une décennie les entreprises ont accumulé une dette peu coûteuse, en élevant le stock global des obligations d’entreprises non-financières à un niveau historique de 13,5 billions de dollars à la fin de l’année dernière, soit le double du niveau réel de décembre 2008. En même temps, et selon les estimations de la Réserve Fédéral nord-américaine, la dette des entreprises aux États-Unis est passée de 3,3 billions de dollars, avant la crise de 2008-2009, à 6,5 billions en 2019. La Chine et les États-Unis sont, de loin, en tête du classement mondial des dix pays ayant la plus grande dette d’entreprise non-financière. Toujours selon l’article du Financial Times mentionné plus haut, ce phénomène s’explique par le fait qu’en lien avec la baisse des taux d’intérêt post-Lehman, mise en place par les banques centrales, les rendements des obligations d’Etat les plus sûres se sont effondrés. Les investisseurs ont alors vu dans les prêts aux entreprises, plus risqués, une manière d’obtenir des bénéfices plus importants. L’article note également que le monde des entreprises endettées est divisé entre les emprunteurs d’un niveau intermédiaire, qui jusqu’à il y a quelques mois pouvaient continuer à emprunter et à rembourser leurs dettes, et les entreprises « zombies », une entreprise sur six aux Etats-Unis, qui, alors même qu’elles ne généraient pas assez de profits pour assurer les paiements de leurs intérêts, pouvaient continuer à reporter la crise tant que les marchés de dette leurs permettaient de se refinancer. Dans un autre article du Financial Times, on peut lire que les entreprises comme Alphabet, Apple, Facebook et Microsoft possédaient un total de 328 milliards de dollars de liquidités à la fin de 2019. Un chiffre qui suggère que ces entreprises agissent en fait comme des prêteurs pour d’autres secteurs, concentrant une grande partie de la dette, notamment dans la « vieille économie ». Cet article du Financial Times signale aussi que l’évolution du type d’endettement des entreprises est en quelque sorte moins risqué pour le système financier dans son ensemble, puisque les banques sont moins exposées à la dette des entreprises que les investisseurs tels que les compagnies d’assurance, fonds de pension ou fonds de placement commun. Cependant, l’article alerte sur le fait que les banques ne pourraient échapper à un effondrement plus large, qui finirait par entraîner des défauts de paiement.
Cette situation constitue une véritable bombe à retardement dans le contexte de la crise déclenchée par le Covid-19. D’abord, il faut noter que 50 % de la dette globale des entreprises est qualifiée comme BBB par des agences telles que Moody’s, S&P ou Fitch. Ceci signifie, que bien qu’il s’agisse d’obligations considérées « investment grade » - c’est-à-dire « de qualité » -, ce sont les pires types d’obligations de cette catégorie. C’est pourquoi une baisse de leur notation les fait rentrer directement dans la catégorie des « junk bonds ». Dans le cas des États-Unis, alors que 40 % de leur dette est classée BBB, 22% des dettes qui arrivent à échéance sont considérées comme des « junk bonds ». C’est-à-dire que presque deux tiers des obligations appartiennent à des entreprises ayant un risque plus élevé de défaut, parmi lesquelles on retrouve un grand nombre d’entreprises de détail. Il en découle que ce ne sont pas seulement les entreprises avec des faiblesses préalables qui sont menacées, mais aussi celles qui étaient jusque-là considérées comme ayant des capacités de recouvrement relativement solides. D’un côté, les entreprises qui souffrent d’annulations massives comme celles de l’hôtellerie ou de l’aviation montrent une très grande vulnérabilité. Une problématique qui touche non seulement les petites et moyennes entreprises de croisière, mais aussi des géants comme Carnival et Royal Caribbean, des titans de l’aviation comme Boeing et American Airlines, ou de l’hôtellerie comme l’entreprise nord-américaine Ryman Hospitality Proporties. De l’autre côté, les compagnies d’énergie nord-américaines, très dépendantes des prix élevés du pétrole, étaient déjà au bord du gouffre et sont en train d’encaisser un coup très dur avec des prix qui ont atteint des niveaux négatifs. Toutefois, le champ des entreprises menacées est encore plus vaste. Les entreprises de l’automobile, celles de l’électronique et les compagnies chimiques demeurent vulnérables en raison des interruptions des chaînes d’approvisionnement. Les entreprises de location des voitures ou les grands opérateurs de cinéma comme l’entreprise étasunienne National Amusements, parmi bien d’autres, ont d’ores et déjà été placées sous surveillance négative par les agences de notation. De plus, il est certain que les banques aideront en premier lieu les grandes entreprises, c’est pourquoi il est probable que les petites et moyennes entreprises soient les plus touchées. Un constat d’autant plus inquiétant que ces dernières sont souvent des maillons cruciaux dans la chaîne d’approvisionnement. Une fois ces liens rompus, une reprise postérieure sera beaucoup plus difficile pour celles-ci. Evidemment, une telle dynamique sera par ailleurs une opportunité pour aller vers une plus grande concentration de capital par le biais de l’acquisition par de grandes entreprises de ces petites et moyennes entreprises.
Compte tenu de ce scénario - même si, contrairement à la crise de 2008/2009, la situation bancaire reste stable - les dettes des entreprises constituent l’un des maillons les plus faibles de la chaîne. Le risque d’une série de banqueroutes en chaîne qui finisse par avoir des conséquences sur les banques est une véritable Epée de Damoclès. Il s’agit là d’une situation qui se pose dans un contexte dans lequel, avec tout ce qui s’est déjà déroulé jusqu’à maintenant, la contraction du PIB mondial – dans la vision optimiste du FMI – serait de l’ordre de 3 %, et le pronostic de la chute du commerce mondial oscille, dans une fourchette large allant de 13 à 32% selon l’OMC. Par ailleurs, si l’on considère uniquement le cas paradigmatique des États-Unis, dans le meilleur des cas l’économie souffrirait d’une contraction de 6 % en 2020, et les pronostics concernant le chômage oscillent de manière effrayante entre 16 et 20 %. Tous ces chiffres – exception faite du cas du commerce mondial dont le pronostic est encore ouvert – dépassent largement les valeurs de la chute de la crise de 2008-2009. Dans ce contexte, les stimuli sans précédent historique, si on tient compte des mesures monétaires et fiscales, qui dépassent aux États-Unis les 5 trilliards de dollars et représentent, en termes de mesures fiscales, 30 % du PIB en Allemagne et Italie, et près de 20 % dans l’État Espagnol, ont pour objet d’éviter cet entrelacement explosif entre les effets de la pandémie et une des faiblesses les plus dangereuses de l’ère post-Lehman. Aussi, et à la différence de la crise de 2008-2009, les mesures actuelles d’intervention étatique n’ont pas pour objet une relance de l’économie, mais plutôt une contention de sa chute. La continuité de la paralysie économique peut, toutefois, être beaucoup plus puissante que les stimuli et c’est pourquoi la plupart des gouvernements tentent de sortir du « confinement » avec des conséquences inconnues en termes sanitaires. Étant donné les circonstances, la « dialectique » entre pandémie et économie émerge comme une des plus grandes inconnues du moment laissant beaucoup d’analystes – comme le note ironiquement Michel Husson – sans lettres dans l’abécédaire pour dessiner l’avenir. (Référence aux débats sur la forme de la reprise, entre reprise en « v », en « u » ou en « w »).
Le sens profond des dettes
Si l’on revient aux dettes des entreprises non-financières, il est intéressant d’aller un peu au-delà de leurs causes immédiates. La croissance accélérée de ce type de dette pendant les plus de dix ans écoulés depuis le début de la reprise post-Lehman reflète parfaitement la faiblesse de la croissance de l’investissement dans le capital fixe. Une situation qui n’est qu’un symptôme profond de la coexistence de grandes masses de liquidités d’une part, et de faibles sources d’investissement rentable, d’autre part. Une contradiction qui, dans une grande mesure, se « résout » à travers la croissance de la dette des entreprises, lieu de destination privilégié et hautement spéculatif de ces grandes masses de liquidités.
Des masses de liquidités qui proviennent soit de sociétés très rentables ayant leur siège dans des pays à hauts revenus - nous avons cité l’exemple d’Alphabet, Apple, Facebook et Microsoft -, soit des programmes de quantitative easing des banques centrales, qui ont sauvé les banques privées lors de la dernière crise, ou encore des taux d’intérêts extrêmement bas qui régissent le « centre » capitaliste depuis plus d’une décennie. Comme l’affirme le géographe David Harvey, la conversion des profits qui exigent leur « kilo de viande fraîche » se fait au sein des institutions financières. Ces institutions, telles que les fonds d’investissement et de pension, ainsi que les banques, entre autres, acheminent le crédit vers des entreprises – dont nombre d’entre elles produisent peu ou pas de bénéfices réels –qui, en utilisant l’argent pour le rachat de leurs propres actions, en élèvent le prix artificiellement, augmentant ainsi la valeur de l’entreprise pour attirer des masses encore plus grandes de capital. Les entreprises d’innovation technologique appelées licornes qui ne réalisent guère de bénéfices mais qui se revalorisent grâce aux constants apports de capital, et qui tendaient à perdre de leur dynamisme, constituent un exemple de ce type d’opérations. Tout un système qui constitue un enchevêtrement presque insondable de paris spéculatifs et de création de dépendance au crédit, tout entier fondé sur l’absence d’investissements réels rentables.
La relation entre manque de ressources d’investissement et augmentation de la dette – non seulement de la dette privée d’entreprise non-financière mais aussi de la dette publique , qui expliquent dans leur ensemble plus de 80 % de l’augmentation extraordinaire de la dette totale dans cette dernière décennie mais aussi les dettes des particuliers – en dit beaucoup sur les limites actuelles de l’auto-reproduction du capital. Une question a la particularité de « préoccuper » non seulement les marxistes mais aussi une grande partie du courant néokeynesien. Dans un récent article, Martin Wolf se demande pourquoi l’économie mondiale actuelle est devenue si dépendante de la dette, et répond que cela exprime un « désir excessif d’épargne » par rapport aux « opportunités d’investissement ». Wolf ajoute que l’augmentation de l’inégalité aux États-Unis s’est traduite par une grande augmentation de « l’épargne » des 1 % les plus riches, qui ne se traduit pas par une augmentation de l’investissement. Au contraire, il affirme que le taux d’investissement chute malgré la diminution des taux d’intérêts réels. Un aspect qui est à la base du phénomène dit d’« hystérésis », qui illustre l’incapacité de l’économie à retourner aux niveaux de fonctionnement antérieurs à la crise, malgré les grandes masses d’argent introduites par les banques centrales. Un élément caractéristique de la dernière reprise et qui est à la base de la thèse de la stagnation séculaire. Pour sa part, David Harvey disait – il y a quelques années – que la croissance ininterrompue de l’accumulation, dans un contexte d’absence d’opportunités d’investissements rentables, exerce une intense pression, sous forme de capital qui vient augmenter de manière illimitée le crédit disponible. Dans ce contexte Harvey développe aussi le concept d’« asservissement par les dettes », comme moyen privilégié du capital pour imposer une forme particulière d’asservissement en consentant des prêts aux travailleurs comme aux capitalistes ou encore aux États.
Cette dynamique profonde d’augmentation des dettes prédatrices, qui sont l’envers de la raréfaction progressive des sources d’investissement lucratif, a eu sa première grande expression dans la crise de 2008-2009, avant de s’exprimer sous la forme de la faiblesse de la reprise post-Lehman que les néo-keynesiens définissent avec les termes d’ « hystérésis » ou de « stagnation séculaire ». Il s’agit plus précisément de la crise du capitalisme dans son régime néolibéral, ainsi que des spécificités de l’internationalisation financière et productive qui l’ont caractérisé. En fait, si le faible investissement explique la lente croissance de la productivité du travail - malgré les grandes avancées technologiques –, la croissance léthargique du commerce mondial se présente, à son tour, comme un des facteurs explicatifs de ce faible investissement. La tempête du Covid-19 se développe dans ce contexte, marqué non seulement par la faiblesse économique mais aussi par des profondes crises politiques et une instabilité géopolitique. La question des configurations qui vont se mettre en place dans la période qui s’ouvre constitue une des plus complexes et intéressantes à élucider.
Qu’est-ce qui vient après ?
La manière dont va se configurer la prochaine période dépend en grande partie des rythmes de la pandémie et des capacités à la contrôler. Le pronostic le plus optimiste est donné – comme d’habitude – par le FMI, considérant que la maladie sera dominée d’ici le prochain semestre et que les conséquences de la crise économique ne dépasseront pas les tendances actuelles. Dans un tel contexte, il prévoit une croissance économique mondiale de 5,6 % pour 2021. Un chiffre qui, s’il semble élevé, est en réalité très bas, puisqu’il inclue la reprise consécutive à la chute de 3 % pour l’année en cours. Il se situe donc, comme le signale le FMI lui-même, en-dessous de la tendance prévue avant à la crise. Il s’agit donc d’un scénario d’« hystérésis » - en termes néokeynesiens – plus aigu que celui qui a caractérisé la reprise de la dernière décennie. Par ailleurs, le FMI imagine certainement de pires scénarios qu’il se garde de publier.
Or, si on ne peut exclure celui-ci, il est probable que la situation soit plus compliquée. Le développement de la maladie et son contrôle relatif se produit par régions, ce qui – en plus de l’évolution des tensions géopolitiques – implique des inégalités qui compliquent une convergence. Le début, par exemple, de l’apparente reprise économique coïncide avec le pire moment de la pandémie et de la crise aux États-Unis. De plus, il est impossible d’affirmer que la plus grande partie des économies qui commencent à tenter de retourner à la normalité ne feront pas face à de nouvelles vagues. C’est pourquoi, elles pourraient être exposées à des reprises et des nouvelles chutes qui, ajoutées aux inégalités internationales, configurent un scénario inégal, incertain et encore plus retardataire en termes de reprise économique. Par ailleurs, en signalant que l’abandon des blocages constitue un processus et non pas un événement, un article de The Economist intègre le concept de « l’économie du 90 % ». À savoir, une situation dans laquelle, par peur de la contamination et de possibles nouvelles vagues – et ce jusqu’à ce qu’un vaccin ne soit trouvé ou que la peur se dissipe –, l’économie ne puisse pas retourner à la normale dans son ensemble, en prenant en compte une baisse de la consommation dans les bars, les restaurants, l’hôtellerie, concernant les voyages ou le transport public, entre autres. Compte tenu de ce scénario général, on ne peut nullement exclure que, dans un enchevêtrement de nouvelles vagues, de reculs, et d’impossibilité du retour à la normale, le maillon faible de la dette des entreprises finisse finalement par exploser et donne lieu à une récession beaucoup plus profonde que la tendance observée jusqu’à présent.
D’autre part, la dynamique de la Chine et de son économie apparaît comme une grande inconnue qui conditionne en même temps les possibles scénarios futurs. Bien que l’on parle d’une reprise plus rapide que prévu, les prévisions de croissance du PIB chinois pour l’année en cours - toujours sur la base du scénario le plus optimiste - sont à peine supérieures à 1 %. Il est compliqué de supposer que, dans ces conditions, l’économie chinoise puisse jouer le rôle de moteur international de l’économie qu’elle avait occupé face à la crise de 2008-2009. Le plan de relance budgétaire de près de 600 milliards de dollars avait provoqué à l’époque un solide rebond de son économie. Celle-ci, en revanche, fait aujourd’hui face à des contradictions telles que le surinvestissement interne, la surcapacité et le surendettement – libellé en yuan cependant –, qui n’existaient pas à l’époque. Quoi qu’il en soit, rien n’est encore fixé. La Chine est une économie nouvelle, et elle peut reprendre de la vigueur même après la crise. La particularité est que, si cela arrive, l’économie prendra certainement une forme très différente de celle des premières années postérieures à la crise de Lehman. En tout cas, il faut s’attendre à une plus grande confrontation dans les espaces mondiaux d’investissement en capital, ce qui entraînera une intensification de la lutte pour les sphères d’influence.
Finalement la question de la Chine nous conduit à écrire au moins quelques lignes sur le destin de la « mondialisation ». Le niveau de dépendance des économies nationales relatif à l’internationalisation du capital et aux dites chaînes de valeur est très élevé. En effet, la pandémie a montré que les États-Unis dépendent de la Chine pour s’approvisionner en médicaments élémentaires et en matériel sanitaire basique. L’enlisement de la mondialisation qui, comme on le signalait, dure depuis un peu plus d’une décennie et sa remise en question, qui a pris différentes formes politiques et économiques ces dernières années, se manifeste plus explicitement aujourd’hui comme un problème de « sécurité nationale ». Le haut degré d’internationalisation de fractions dominantes du capital approfondit leur contradiction avec la structure des États nationaux qui, en dernière instance, lui garantissent les conditions globales et locales pour l’accumulation. Il y aura sans aucun doutes des pressions pour démanteler certaines chaînes de valeur mondiales, en particulier dans le secteur de la santé et il y aura certainement des modifications dans des sphères déterminées. Cependant, pour envisager le problème plus largement – dans une période qui sera par ailleurs marquée par l’année électorale nord-américaine – il est nécessaire de prendre en compte au moins trois facteurs. Le premier est la résistance du capital le plus concentré face aux pressions qui vont à l’encontre de l’internationalisation. Le deuxième est que pour réindustrialiser et ré-équiper la production dans les pays centraux, il serait nécessaire de conquérir, dans les centres capitalistes, des salaires du niveau de ceux que les grandes multinationales nord-américaines et d’autres pays obtiennent en Chine. Le troisième, c’est que le démantèlement des chaînes de valeur – une configuration extrêmement complexe et même difficile à saisir par les analystes – impliquerait un investissement massif du capital dans le centre, c’est à dire le dépassement de l’une des plus profondes faiblesses qui a marquée la dernière décennie et demie. Rappelons que le plus grand processus d’investissement dans les nouvelles technologies, économisant le travail dans les pays centraux pendant ces quarante dernières années, a eu lieu pendant la décennie 1990 et les premières années 2000, comme complément de la délocalisation de l’industrie vers le Mexique, le Sud Est Asiatique, les pays d’Europe de l’Est, l’ex-URSS et la Chine. Il y a une contradiction aiguë dans la division internationale du travail, établie tout au long de cette dernière période, mais sa transformation est loin d’être simple.
En conclusion, il est évident que ces difficultés vont pousser à avancer vers un approfondissement de la flexibilisation du travail. Une attaque qui, à mesure que l’on retourne à la normale, devra faire face à la continuité des processus de lutte des classes qui ont émergé de façon importante dans le monde d’avant la pandémie. En réalité, cette crise a montré le rôle fondamental du travail humain comme moteur de l’économie. Les progrès technologiques sont très profonds, mais toujours complémentaires de celui-ci. Dans la période à venir, en plus de faire face aux attaques contre les conditions de travail, la classe ouvrière devra inscrire dans son programme la lutte pour l’appropriation des avantages tirés des nouvelles technologies. Soit les grandes entreprises en profiteront pour augmenter l’exploitation et les souffrances, soit la grande majorité de la population s’appuiera dessus pour améliorer les conditions de l’existence humaine.