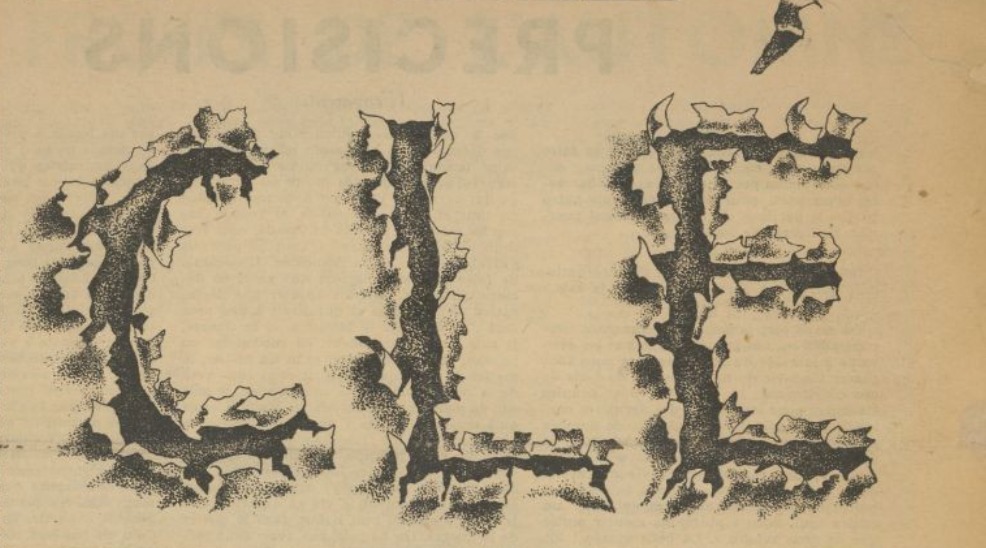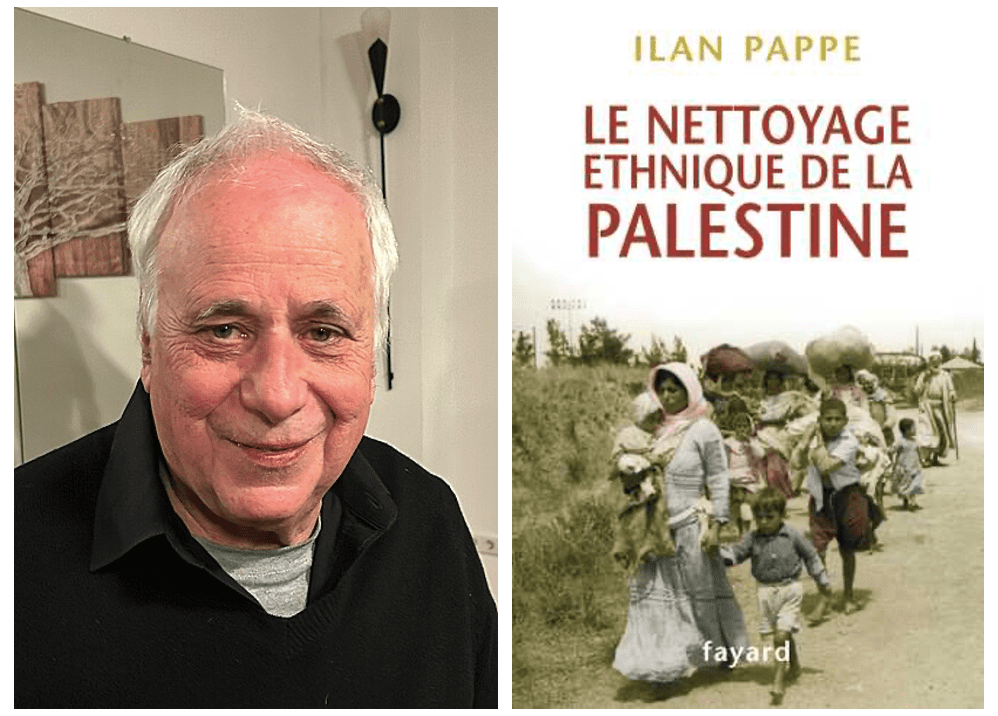Crédits Photo : Capture d’écran. Bande annonce.
En 2044, la science a démontré l’existence des vies antérieures et l’origine des troubles psychiques : la rémanence des souvenirs de nos vies passées. Dans ce monde régi par l’intelligence artificielle, où les machines remplacent la force de travail, Gabrielle espère obtenir l’un des rares postes de direction qui emploient encore des humains. Mais, pour ce faire, elle est contrainte de suivre une cure de purification qui, lui ôtant ses souvenirs, fera d’elle un être sans émotion. À mesure que les séances s’enchaînent, Gabrille redécouvre ses autres vies et ses multiples rencontres avec Louis avec lequel elle est indissociablement liée. Dans le Paris de la Belle Époque, à Los Angeles en 2014 et dans le monde dystopique de 2044, la même tragédie se répète.
À chaque époque les amants se manquent. S’ils savent la vérité de leur désir et reconnaissent dans l’autre l’être qui leur est promis, ils sont pris dans les rouages d’une machine sociale dont la force les dépasse et qui parvient toujours à rallier, contre l’amour, l’un des deux amants. Tableau cauchemardesque de la domination du capital sur les sentiments, cette triple tragédie explore les contradictions de l’amour moderne et dit à la fois la résistance révolutionnaire du désir en même temps que la peur d’aimer qui, paralysant la résistance, défait le pari d’aimer.
La poupée et la bête
Deux analogies structurent l’ensemble du récit : la poupée et la bête. En 1910, Gabrielle, pianiste, est mariée à un fabricant de poupée. À Los Angeles, en 2014, une autre poupée hante l’appartement qu’elle a pour mission de garder. En 2044, dans un Paris vide de vie, alors qu’elle doit en passer par une cure de purification de sa mémoire génétique, l’intelligence artificielle qui semble superviser l’organisation de la société lui attribue une aide robotique, surnommée poupée. Le visage neutre, les traits sans émotion, le regard qui tombe dans le vague, la poupée dit la violence de la pacification antisociale. Alors qu’une grave crise économique frappe le monde et que les machines ont remplacé les travailleurs, Gabrielle espère obtenir les rares postes de direction qui sont encore occupés par des humains.
Lors de son entretien d’embauche, son interlocuteur lui fait savoir qu’ils exigent, par-dessus tout, la maîtrise et la retenue d’un être sans émotion. Hantée par le souvenir de ses autres vies, Gabrielle doit perdre la mémoire pour obtenir un emploi. Tel est au fond l’image archétypale du travailleur idéal : un être sans émotion, dont l’intimité doit être expurgée de toute la profondeur du souvenir, du désir et du doute, pour accomplir sa tâche productive. Il ne suffit pas de soumettre les corps, il faut leur faire perdre jusqu’au souvenir de leur soumission. À l’occasion d’une scène saisissante, dans un café du Paris de la Belle Époque, Gabrielle mime devant Louis les traits impersonnels des poupées fabriquées dans l’usine de son époux : le visage gelé, son sourire évanoui, Léa Seydoux, d’une beauté de fantôme et de cadavre, adopte, pour quelques instants, les traits de ce masque de fer que la société bourgeoise impose à ses enfants prodigues.
C’est au fond l’image même du tableau cauchemardesque que Marx dressait de la subsomption réelle du travail sous le capital : un commandement si absolu du capital sur la vie que la société elle-même n’apparaît plus que comme le simple résultat « de la puissance productive du capital, et non [de la] puissance productive du travail, ou [de la] puissance productive du travail pour autant seulement qu’il est identique au capital » [1]. Alors qu’elle fait visiter l’usine à Louis, la caméra s’attarde ainsi sur les ouvriers anonymes et silencieux, sur leurs gestes mécaniques et donne à voir la production du travailleur lui-même tandis qu’un surveillant explique chaque étape de la confection : membre par membre, la poupée est assemblée et, sitôt sa face et sa peau peintes, suspendue à un portant. Et cette fabrique où l’on produit les producteurs dit toute la violence que l’ordre bourgeois fait subir au désir.
Mais cette usine est aussi une illusion. Qu’il s’agisse de Louis ou de Gabrielle, chacun incarne à tour de rôle la force de résistance du désir, la mémoire qui ne passe pas, le souvenir qui demeure et le cœur qui continue de battre à contretemps du rythme des machines. Car cette force du désir et de la jeunesse non seulement insiste, mais résiste aussi. Gabrielle fait rêver jusqu’aux machines et suscite le désir de sa poupée robotique. S’il y a de l’oppression, c’est aussi que la résistance est toujours à défaire. Orwell est impossible et il n’y a pas de société unidimensionnelle car il n’est pas de pouvoir qui puisse comprimer jusqu’au bout la révolte. Mais alors viennent la bête et le cri. Car les deux amants ne se rencontrent véritablement jamais. Ni à Paris, avant que la Première Guerre mondiale n’éclate, ni à Los Angeles, ni dans le monde dystopique qui succède à une mystérieuse catastrophe. Si les amants se rencontrent, c’est par la seule médiation du souvenir.
La bête, en effet, ce n’est pas le capital lui-même, mais ce qu’il fait de nous. Prisonnière du mariage, Gabrielle refuse de céder sur son désir et meurt sans aimer. À Los Angeles en 2014, Louis, dont le personnage est inspiré d’Elliot O. Rodger, un « incel » de vingt-deux ans qui avait tué six femmes, le 24 mai 2014, choisit Gabrielle pour victime. La pourchassant jusqu’à sa chambre, il la tue, accomplissant le « temps de la rétribution ». En 2044, Gabrielle, dont il s’avère que la mémoire génétique ne peut être effacée, tente par tous les moyens de retrouver Louis qui hésitait à entreprendre la cure de purification. Alors qu’ils se retrouvent, Louis, balafré d’un sourire glacial, révèle qu’il est désormais employé au ministère de la justice et que sa mémoire a été effacée. Anéantie, Gabrielle s’effondre et hurle son désespoir.
Une tragédie politique : de la peur d’aimer au pari d’amour
À chaque époque, les amants se manquent, non qu’ils ne se soient pas reconnus, ni qu’ils aient manqué la signification de leur désir, mais du fait que l’un a trahi l’autre. La bête rode, comme une menace, et elle révèle son vrai visage lorsque que l’un des amants s’accorde avec l’état présent des choses. La tragédie des amants, ce n’est pas que le monde soit hostile à leur amour, mais que l’un trahisse l’autre et lui préfère l’histoire.
À remonter jusqu’à la source de cette trahison, il y a la peur effroyable d’aimer qui paralyse la main à l’heure où la caresse appelle. Nulle fatalité ici. Gabrielle tend la main à Louis, dans l’usine de poupée, mais prend peur. Une inondation soudaine les contraint à fuir. Un court-circuit met le feu à l’atelier. Tentant de s’échapper par la cave submergée, les amants se noient sans s’être rencontrés. En 2014, alors qu’un tremblement de terre frappe Los Angeles, Gabrielle émue à la vue de Louis s’approche de lui et, certaine qu’il s’agit de l’être qui lui est promis, lui propose de la suivre. Prisonnier de son idéologie fanatique, le jeune homme refuse, non sans hésiter. Haïssant toutes les femmes car il n’en a jamais connu, Louis est persuadé que ce témoignage de tendresse est une ruse perverse qui le détourne de sa vengeance, que quiconque l’aime lui ment. En 2044, Gabrielle, qui garde le souvenir de ses vies antérieures, pressent dès la première rencontre, son importance. Mais elle tarde à le revoir tandis qu’il sacrifie son cœur sur l’autel de sa carrière. À chaque fois, la peur d’aimer fait triompher ce que nous sommes sur ce que nous pouvons être et conserve notre être dans ce qu’il a de mutilé.
Alors que dans Nocturama, Bonello représentait encore la brutalité de l’ordre social comme une force extérieure, en filmant les cohortes policières entrant, comme des ombres, dans la Samaritaire, le centre commercial où ses jeunes personnages révoltés s’étaient réfugiés après avoir posé des bombes dans plusieurs lieux parisiens, la bête est désormais un monstre intime. En témoigne également la complexification de la dialectique de l’intérieur et de l’extérieur qui organisait Nocturama en deux grandes séquences : à la préparation et la réalisation des attaques des adolescents succédait le long huit-clos au terme duquel ils trouveraient la mort sous les balles de la police. Empruntant sa grammaire visuelle au slasher movie, le deuxième récit, fortement marqué par l’influence de David Lynch, multiplie les brèches entre les espaces : si Gabrielle, qui doit garder une grande maison en l’absence de son propriétaire, prête une attention constante à en verrouiller les entrées, elle ne cesse également d’en réouvrir les portes, faisant, d’une certaine manière le pari de l’inconnu. À l’inverse, dans le premier récit, les deux amants se noient devant la porte de la cave qu’ils ne parviennent pas à ouvrir de l’intérieur, faisant symboliquement écho à la décision de Gabrielle de refouler son désir d’aimer. La séparation et la clôture de l’espace ne sont plus imputables à des forces objectives mais dérivent, en dernière analyse, d’un choix d’amour manqué.
Si La Bête est une tragédie, elle l’est en un sens très particulier. Sans jamais dissoudre le tragique dans l’image d’un destin invincible sur lequel les individus n’auraient aucune prise, Bonello montre à la fois la force de la répression sociale et sa puissance corruptrice en même temps qu’il place au cœur du choix d’aimer le pari fondamentalement politique que la peur d’un des deux amants, à tour de rôle et à chaque fois, paralyse et refoule.
Si Bonello, qui a fait de la jeunesse et de son mal-être un de ses objets de prédilection, refuse que l’on considère son œuvre comme un cinéma générationnel, force est de constater qu’il saisit les contradictions contemporaines de la tragédie amoureuse. Chacun des trois récits semblent presque illustrer les trois facteurs fondamentaux qui caractérisaient, pour Alexandra Kollontaï, la crise érotique de la société bourgeoise : « Ces trois facteurs fondamentaux, déformant la psychologie contemporaine – un égocentrisme extrême, l’idée des droits de propriété des époux l’un sur l’autre, la conception de l’inégalité des sexes dans la sphère psycho-physiologique –, obstruent la route menant à la solution du problème sexuel » [2]. Si l’attachement de Gabrielle à l’égard de son époux illustre les drames de l’amour-propriété lorsque le commandement marital est intériorisé, le fanatisme meurtrier de Louis, à Los Angeles, et sa haine des femmes témoignent de la misère du masculinisme. Quant à la société atomisée du Paris dystopique de 2044, où Gabrielle erre seule dans les rues désertes et où elle demeure la seule dont la mémoire conserve encore quelque chose de son propre passé, elle témoigne de cet individualisme exacerbé.
Si les deux amants ne font jamais en même temps le difficile pari d’aimer, c’est par la médiation du souvenir et comme par-delà le temps que la peur d’aimer sera vaincue. L’amour sera celui d’une vie future où la contradiction qui sépare les amants trouvera à sa résorber. Le cri final de Gabrielle, c’est aussi le désespoir d’attendre encore sur l’avenir et la nostalgie qui sera la sienne d’un futur qu’elle ne connait pas encore. Comme l’écrivait encore Kollontaï, « le drame de l’humanité présente consiste non seulement en ce que, devant nos yeux, se brisent les formes usuelles d’union entre les sexes et les principes qui les règlent, mais encore en ce que des bas-fonds sociaux s’élèvent les frais parfums inconnus d’une nouvelle forme de vie, emplissant l’âme humaine de la nostalgie d’idéaux à venir, irréalisables aujourd’hui encore. Nous, les hommes d’un siècle de propriété capitaliste, d’un siècle de luttes des classes aiguës, nous pensons encore sous le signe funeste d’une invincible solitude morale » [3]. Même en amour, il faut prendre parti.
[1] Karl Marx, Le chapitre VI : manuscrits de 1863-1867 - Le Capital, livre I, Paris, Les éditions sociales, 2010, p. 187.
[2] Alexandra Kollontaï, Marxisme et révolution sexuelle, Paris, La Découverte, 2001, p. 177.
[3] Ibid., p. 172. Je souligne.